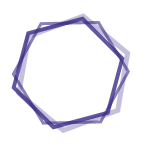ABSTRACT
Among traumas, cranial involvement occupies a special place due to their severity and the importance of the sequelae that they can cause. They are said to be serious when the Glasgow Scale (GCS) ≤ 8. The frequency of severe brain injury in the population in African studies ranges from 3.5 to 7. Mortality is, however, poorly known in developing countries, which led us to initiate this work, which aimed to study the epidemiological, clinical and evolutionary aspects of severe traumatic brain injury in the multipurpose intensive care unit of Gabriel Touré University Hospital. MATERIAL AND METHOD: 24-month retrospective study, descriptive and analytical, including all severe traumatic brain injury patients hospitalized in the resuscitation department of Gabriel Touré University Hospital during this study period. RESULTS: During the periodof 1165 patients admitted to the service, 72 were hospitalized for severe cranio-encephalic trauma for a prevalence of 6%. The age group of 21 - 40 years was the majority with (23) or 44.4% and the average age was 30.93 ± 18.8 years with extremes of 8 months and 79 years.The male sex was predominant with (65) or 90.3%, and a sex ratio of 9.28. During our study, (57) or 79.2% of serious traumatic brain injuries were due to road accidents with motorcycle-motorcycle collisions as a mechanism in (20) or 27.8%. Shopkeepers, and students were the most affected social strata with respectively (22) or 30.6% and (20) or 27.8%. Patient transport was provided by non-medical ambulances for (31) or 43.1% and admission time was between 30 minutes and 6 hours in (16) or 22.2% of cases. (62) or 86.1% had GCS between 6-8 and bilateral mydriasis was present in (10) or 13.9% of patients. (9)or 12.5% of patients had hypotension (systolic blood pressure<90 mm Hg) on admission and average blood pressure<90 mmHg was observed in (32) or 44.4% of patients. (23) or 31.9% had a SPO2 <90%. Cranio-encephalic scanning was performed in 62 or 86.1% and discovered as lesions (25) or 34.9% hemorrhagic contusions followed by extradural hematomas (13) or 18.1%. (63) or 87.5%, patients were intubated-ventilated-sedated in addition to resuscitation. (28) or 38.9% of patients had undergone a surgical intervention with (9) or 12.5% having osmotherapy.The evolution was marked by death of (48) or 66.7%. CONCLUSION: Severe cranio-encephalic trauma represents a major cause of morbidity and mortality. The establishment of pre-hospital medicine will allow better care and reduction of mortality by early and continuous management of ACSOS and respiratory and / or hemodynamic distress, which are very often associated with severe TCE.
Parmi les traumatismes, les atteintes crâniennes occupent une place particulière du fait de leur gravité et de l'importance des séquelles qu'elles peuvent entraîner. Ils sont dits graves quand le score de Glasgow (GCS) ≤ 8. La fréquence des traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) graves au sein de la population dans les études africaines varie entre 3,5 et 7. La mortalité est cependant mal connue dans les pays en voie de développement ce qui nous a conduit à initier ce travail qui avait pour objetd'étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et évolution des traumatisés crâniens graves au service de réanimation polyvalente du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. MATÉRIEL ET MÉTHODE: Etude, descriptive et analytique à collecte rétrospective s'étant déroulée sur 24 mois, incluant tous les patients traumatisés crânio-encéphaliques graves hospitalisés dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré durant cette période d'étude. RÉSULTATS: Durant la période sur 1165 patients admis dans le service.72 ont été hospitalisés pour traumatisme crânio-encéphalique grave soit une prévalence de 6%. La tranche d'âge de 21 - 40 ans était majoritaire avec(32) soit 44,4% et l'âge moyen était de 30,93 ±18,8 ans avec des extrêmes de 8 mois et 79 ans. Le sexe masculin était prédominant avec (65) soit 90,3%, et un sex-ratio de 9,28. Durant notre étude (57) soit 79,2% des TCE graves étaient dus aux accidents de la voie publique avec comme mécanisme les collisions moto-moto dans (20) soit27,8%. Les commerçants, et les élèves et étudiants étaient les couches sociales les plus touchées avec respectivement(22) soit 30,6% et (20) soit 27,8%. Le transport était assuré par des ambulances non médicalisées à(31) soit 43,1% et le délai d'admission était compris entre 30 minutes et 6 heures dans (16) soit 22,2% des cas.(62) soit 86,1% avaient GCS entre 6-8 et une mydriase bilatérale était présente chez (10) soit 13,9 % des patients. (9) soit 12,5% des patients avaient présenté une hypotension (pression artérielle systolique< 90 mm Hg) à l'admission et une pression artérielle systolique ≤ 90 mm Hg avait été observée chez (32) soit 44,4% des patients. Durant notre (23) soit 31,9% avaient une SPO2 < 90%. Le scanner cranio-encéphalique a été réalisé chez (62) soit 86,1% et retrouvait comme lésions, les contusions hémorragiques (25) soit 34,9% suivis des hématomes extraduraux (13) soit 18,1%.(63) soit 87,5% des patients ontété intubés -ventilés-sédatés en plus à des mesures de réanimation. (28) soit 38,9% des patients avaient subi une intervention chirurgicale associée chez (9) soit 12,5% à une osmothérapie. L'évolution a été marquée par une létalité de (48) soit 66,7%. CONCLUSION: Les traumatismes crânio-encéphaliques graves représentent une cause majeure de morbi-mortalité. La mise en place d'une médecine préhospitalière permettra une meilleure prise en charge et la réduction de lamortalité.Par une prise en charge précoce et continue des ACSOS et des détressés respiratoires et/ou hémodynamiques qui sont très souvent associées au TCE grave.
ABSTRACT
OBJECTIVES: to identify the main causative agents of infection associated with care and their susceptibility to antibiotics used and to identify risk factors for care-associated infection. MATERIAL AND METHODS: This was a cross-sectional study with prospective data collection, conducted from 1 November 2016 to 1 April 2017 among all children admitted to the pediatric surgery department. Non-consenting parents and cases of necrosectomy were included in this study. RESULTS: Our study involved 200 patients, 30 of whom presented a care-associated infection (15% infection rate). The average age of patients with infection was 56.33 ± 48.66 months (1 and 180 months). The main pathogens responsible for infection of the operative site were: Escherischia coli (4 cases), Acinetobacterbaumanii (3 cases), Klebsiella pneumoniae (2 cases), Staphylococcus aureus (2 cases), Enterobacter cloacae (1case), Pseudomonas aeruginosa (1 case) and Enterobacter faecalis (1 case). In the burned patients, the organisms found were: Acinetobacter baumanii (7 cases), Klebsiella pneumoniae (6 cases), Staphylococcus aureus (6 cases), Escherischia coli (4 cases), Pseudomonas aeruginosa (2 cases) and Enterobacter faecalis (2 cases). Escherichia coli was noted in urinary tract infection. Antibiotics tested were amoxicillin, amoxicillin-clavulanic acid, ceftriaxone, imipenem, gentamicin and ciprofloxacin. The mode of recruitment and the duration of hospitalization were the risk factors noted. CONCLUSION: The infection associated with care is a frequent occurrence in our practice. These infections mainly occur at the operating sites. The germs found were: Acinetobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. They are all sensitive to imipenem and resistant to amoxicillin. The infection remains formidable in health care. It is essential to give special attention to the prevention of infectious risk, especially in the surgical setting.
OBJECTIFS: déterminer les principaux germes responsables d'infection associée aux soins et leurs sensibilités aux antibiotiques utilisés et d'identifier les facteurs de risque d'infection associée aux soins. MATÉRIEL ET MÉTHODES: Il s'agissait d'une étude transversale avec recueil prospectif des données, réalisée du 1er Novembre 2016 au 1er Avril 2017 chez tous les enfants admis au service de chirurgie pédiatrique. Les parents non consentants et les cas de nécrosectomie n'ont été inclus à cette étude. RÉSULTATS: Notre étude a concerné 200 patients, parmi lesquels 30 ont présenté une infection associée aux soins (taux d'infection de 15%). L'âge moyen des patients avec infection a été de 56.33± 48.66 mois (1 et 180 mois) .Les principaux germes responsables de l'infection du site opératoire ont été : Escherischia coli (4 cas), Acinetobacter baumanii (3 cas), Klebsiella pneumoniae (2 cas), Staphylococcus aureus (2 cas), Enterobacter cloacae (1cas), Pseudomonas aeruginosa (1 cas) et Enterobacter faecalis (1 cas). Chez les patients brûlés les germes retrouvés ont été: Acinetobacter baumanii (7 cas), Klebsiella pneumoniae (6 cas), Staphylococcus aureus (6 cas), Escherischia coli (4 cas), Pseudomonas aeruginosa (2 cas) et Enterobacter faecalis (2 cas). L'Escherischia coli a été noté dans le cas d'infection urinaire.Les antibiotiques testés étaient : l'amoxicilline, l'association amoxicilline-acide clavulanique, leceftriaxone, l'imipenème, la gentamicine et la ciprofloxacine. Le mode de recrutement et la durée d'hospitalisation ont été les facteurs de risque notés. CONCLUSION: L'infection associée aux soins est un événement fréquent dans notre pratique. Ces infections surviennent majoritairement sur les sites opératoires.Les germes retrouvés ont été : Acinetobacters, Escherischia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,Staphylococcus aureus.Ils sont tous sensibles à l'imipenème et résistants à l'amoxicilline.L'infection demeure redoutable en milieu de soins. Il est essentiel d'accorder à la prévention du risque infectieux une attention particulière surtout en milieu chirurgical.
ABSTRACT
OBJECTIVES: To study health care-associated infections (HCAI) in teaching hospital Gabriel TOURE. METHODOLOGY: This was a prospective study of 6 months (from April to September 2016) which included patients admitted to the General Surgery Department, operated or not, except those who had undergone a necrosectomy. The criteria used for the diagnosis of the infection were those of the CDC of Atlanta. RESULTS: A total of 200 patients were included in the study. Twenty one patients developed IAS that is a frequency of 10.5%. There were 11 men and 10 women with a mean age of 37.7 years with a standard deviation of 17.6 years. Surgical site infection was the most common HCAI (77.3%) followed by urinary tract infection (13.6%) and burn infection (9.1%). The influencing factors were those related to the patients (nutritional status p = 0.004, anemia RR = 3.1 IC p = 0.003 and diabetes), those related to the surgical intervention (the duration of the intervention ≥ 2H, p = 0,0001, the Altemeier class 3 and 4, RR = 4.24, IC p = 0.005, the number of interveners in the blocks ≥7, p = 0.000, the NNISS score 1 and 2 p = 0.0009), invasive procedures (bladder catheter ≥ 4 days p = 0.0000). Escherichia coli was the most isolated microorganism (31.2%) followed by Klebsiella pneumonia and A baumannii (18.7%). The treatment was local (twice-daily dressing with antiseptics), surgical (necrosectomy 16% and re-intervention 10%) and general (adapted to the antibiogram). The consequences of HCAI were an extension of total hospital stay (greater than 7 days) with p = 0.0000, morbidity 3% and mortality 5%. CONCLUSION: HCAI remains a concern in our country and globally. They prolong the hospital stay. The implementation of a prevention, control and surveillance program will improve the quality of care by significantly reducing HCAI.
Une infection est dite associée aux soins (IAS) si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge. L'OBJECTIF ÉTAIT: d'étudier les infections associées aux soins en chirurgie générale du CHU Gabriel Touré. MÉTHODOLOGIE: Il s'agissait d'une étude prospective de 6mois (d'avril à septembre 2016) intéressant les malades hospitalisés dans le service de chirurgie générale opérés ou non, sauf ceux ayant subi une nécrosectomie. Les critères utilisés pour le diagnostic de l'infection ont été ceux du CDC d'Atlanta. RÉSULTATS: Au total 200 malades ont été inclus dans l'étude. Vingt un patients ont développé des IAS soit une fréquence de 10,5%. Il s'agissait de 11 hommes et 10 femmes ayant un âge moyen de 37,7 ans avec un écart type de 17,6 ans. L'infection du site opératoire a été la plus fréquente des IAS (77,3%) suivie par l'infection urinaire (13,6%) et l'infection des brûlures (9,1%). Les facteurs influençant ont été ceux liés aux malades (état nutritionnel p=0,004 ; anémie RR=3,1 IC p=0,003 et diabète), ceux liés à l'intervention chirurgicale (la durée de l'intervention sup ≥2H p=0,0001 ; la classe d'Altemeier 3 et 4 ; RR=4,24 ; IC p=0,005 ; le nombre d'intervenants au blocs ≥7 ; p=0,000 ; le score de NNISS 1et 2 p=0,0009), les actes invasifs (sondage vésical ≥ 4 jours p=0,0000). Escherichia coli a été le germe le plus isolé parmi les micro-organismes (31,2%) suivi de Klebsiella pneumonia et A baumannii (18,7%). Le Traitement a été local (pansement biquotidien avec des antiseptiques), chirurgical (nécrosectomie 16% et ré-intervention 10%) et général (adapté à l'antibiogramme). Les conséquences des IAS ont été le prolongement de la durée totale d'hospitalisation (supérieur à 7 jours) avec p= 0,0000, la morbidité 3% et la mortalité 5%. CONCLUSION: Les IAS demeurent préoccupantes dans notre pays comme à l'échelle mondiale. Elles prolongent le séjour hospitalier. La mise en Åuvre d'un programme de prévention, de contrôle et de surveillance permettra d'améliorer la qualité des soins en réduisant considérablement les IAS.
ABSTRACT
An infection is said to be associated with care (IAS) when it occurs during or after a patient's management (PEC). A delay of at least 48 hours after admission is commonly accepted to distinguish a nosocomial infection from a community infection.in 2009, WHO estimated that 1.4 million people were sick in the world afterhospital-acquired infections. This prevalence remains largely underestimated in Sub - Saharan Africa, and particularly in Mali, which led us to initiatethiswork, whichaimed to describe the epidemiological and clinical aspects of nosocomial infections, determine their frequency and identify the germs responsible. MATERIAL AND METHODS: This was a prospective study, over 12 months from January 1st to December 31st, 2016, in the resuscitation department of CHU Gabriel Touré. Including all patients with a temperature greater than or equal to 38 ° C occurring after at least 48 hours of admission. The data were collected through the surveycards and medical records. The input and analysis made respectivelyfrom Epi info software and the 2016 Office Pack (Word, Excel, Power Point). RESULTS: Duringourstudy of 200 hospitalized patients we collected 35 IAS cases, aprevalence of 17.5%. The male sex was predominant with 60.5% and a sex ratio = 1.53. The average age was 34.28 ± 19.11 yearsold. The traumatized head with 10 cases (28.5%) were the most represented, followed by surgery postoperative 7 cases (20%) and burned 5 cases (14.2%). We carried out 51 samples (15 bronchial samples all positive, 13 ECBUs of which 11 positive, 7 blood cultures, one positive, 12 swabs all positive). The diagnoses retainedwere: ventilated lungdisease 12 cases (34.3%), urinary infection alone 8 cases (22.9%), 6 cases (17.1%) of surgical site infection, 6 cases (17.1%) ) of soft tissue infection and 3 cases (8.6%) of pneumopathy associated with urinary tract infection. The germs found were multidrug-resistant bacilli (BMR), for bronchial samples (Klebsialla pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Echerichia coli). ECBU were found 08 cases of Echerichia coliand 01 case of enterococcusfaecalus, and 2 cases of association Echerichia coli and enterococcus faecalus; blood cultures: staphylococcus aureus. The swabsfound: Klebsialla pneumonia, Echerichia coli, Acinetobacter baumanii enterobacter, cloecae, Staphylococcus aureus, Providencia stuartii, Proteus mirabilis. The average duration of treatment of patients with IAS was 8 days with extremes of 2 to 15 days. The mortality was 57.1%. CONCLUSION: This study allowed us to notice a resistance of different germs to antibiotics. It is therefore necessary to change the behavior of our health care facilities in order to meet this challenge.
Une infection est dite associée aux soins (IAS) lorsqu'elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (PEC) d'un patient. Un délai d'au moins 48 heures après admission est communément accepté pour distinguer une infection nosocomiale d'une infection communautaire. En 2009, l'OMS estimait que 1,4 millions de personnes étaient malades dans le Monde de suite d'infections contractées en milieu hospitalier. Cette prévalence reste largement sous-estimée en Afrique Sub-saharienne et particulièrement au Mali ce qui nous a conduit à initier ce travail qui avait pour object de décrire les aspects épidémio - cliniques des infections nosocomiales déterminer leur fréquence et d'identifier les germes responsables. MATÉRIELS ET MÉTHODES: Il s'agissait d'une étude prospective, sur 12 mois allant du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016 au service de réanimation de CHU Gabriel Touré, incluanttous les patients présentant une température corporelle supérieure ou égale à 38°C apparaissant après au moins 48 heures d'admission. Les données ont été collectées par le biais des fiches d'enquêtes et des dossiers médicaux. La saisie et l'analyse faites respectivement à partir logiciel Epi info. RÉSULTATS: Durant notre étude sur 200 patients hospitalisésnous avons enregisytré 35 cas IASsoit une prévalence de 17,5%. Le sexe masculin était prédominant avec 60,5% et unsexratio=1,53. La moyenne d'âge était de 34,28 ans± 19,11 ans.Les traumatisés crâniens avec 10 cas (28,5%) étaient les plus représentés, suivis des post opératoire de chirurgie 7 cas (20%) et des brulés 5 cas (14,2%).Nous avons réalisé 51 prélèvements (15 prélèvements bronchiques tous positifs, 11 ECBU dont 11 positifs,7 hémocultures dont unepositive, 12 écouvillonnages tous positifs).Les diagnostics retenus étaient : les pneumopathies acquises sous ventilation 12 cas (34,3%), l'infection urinaire seule 8 cas (22,9 %), 6 cas (17,1%) d'infection du site opératoire, 6 cas (17,1%) d'infection des parties molles et 3 cas(8,6%) de pneumopathie associée à une infection urinaire. Les germes retrouvés étaient des bacilles multi-résistantes (BMR), pour les prélèvements bronchiques (Klebsialla pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Echerichia coli). Les ECBU ont retrouvé 08 cas de Echerichia coli et 01 cas d'enterococcus faecalus, et 2 cas associant Echerichia coli et l'enterococcus faecalus.l'hémoculture : staphylococcus aureus. Les écouvillonnages ont retrouvé, Klebsialla pneumonie, Echerichia coli, Acinetobacter baumanii enterobacter, cloecae, Staphylococcus aureus, Providencia stuartii, Proteus mirabilis. La durée moyenne du traitement des patients avec IAS était de 8jours avec des extrêmes de 2 à 15 jours. La mortalité était de 57,1%. CONCLUSION: Cette étude nous a permis de constater une résistance des différents germes aux antibiotiques. Il faut donc un changement de comportement au niveau de la pratique des soins de nos structures sanitaires pour relever ce défi.
ABSTRACT
INTRODUCTION: Peribulbar anesthesia (PBA) involves the injection of local anesthetic of volume around the globe and outside the fasciomuscular cone, which will then diffuse from the peribulbar space to the retrobulbar space. The goal was to evaluate the safety and efficacy of PBA in cataract surgery in Secondary Ophthalmology Center. PATIENTS AND METHOD: this was a cross-sectional study over two months. Our population consisted of all patients admitted to the anesthesia room, scheduled for cataract surgery and the PBA had been completed. The data was analyzed using Epi Info software version 7.2. The correlations were carried out using Khi2 with a threshold of significance (p <0.05). RESULTS: A total of 285 patients were included and sex-ratio H/F = 0,72. Average age of 62 +/- 12 years. Lidocaïne 2% and Bupivacaine 0.5% was used in combination at equal volume. The anesthesia was tolerated in 99,3% of patients. We observed 77,19% total analgesia and 13,33% chaemosis. CONCLUSION: Peribulbar anesthesia allows the easy realization of cataract surgery with great safety and efficiency.
INTRODUCTION: l'anesthésie péribulbaire (APB) consiste à l'injection d'anesthésique local autour du globe et en dehors du cône fasciomusculaire. Le produit diffuse ensuite de l'espace péribulbaire vers l'espace rétrobulbaire. L'objectif était d'évaluer la tolérance et l'efficacité de l'APB dans la chirurgie de la cataracte dans un centre d'ophtalmologie secondaire. PATIENTS ET MÉTHODE: il s'agissait d'une étude transversale sur deux mois. Notre population était constituée par tous les patients admis en salle d'anesthésie et programmés pour la chirurgie de la cataracte chez qui l'APB avait été réalisée. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel Epi Info version 7.2. Les corrélations ont été réalisées à l'aide de Khi2 avec un seuil de significativité (p< 0,05). RÉSULTATS: Au total, 285 patients ont été inclus, avec un sex-ratio H/F de 0,72. L'âge moyen était de 62 ans avec un écart type de 12ans. La lidocaïne 2% et labupivacaïne 0,5% étaient utilisées en association à volume égal. L'anesthésie a été tolérée chez 99,3% des patients. Nous avons observé77,19%d'analgésie totale, 13,33% de chémosis conjonctival. CONCLUSION: L'anesthésie péribulbaire permet la réalisation facile de la chirurgie de la cataracte avec une bonne tolérance et une meilleure efficacité.
ABSTRACT
The severity of a blood pressure spike is more closely associated with serious organ dysfunction, which can be life-threatening in the short term, than with the blood pressure level itself. A hypertensive emergency is defined as the presence of high blood pressure associated with acute organ dysfunction. The specific nature of high blood pressure in black patients may cause more frequent hypertensive emergencies. In this retrospective case study, we report our experience and highlight the specific prognosis for black African patients. We examined three patients, aged 27, 47, and 59 years, admitted to intensive care for a hypertensive emergency with neurological distress, and all in status epilepticus. Average blood pressure was 171 mm HG. Treatment included intubation, ventilation, and induction of a barbiturate coma, plus antihypertensive treatment. The outcome was favorable, with an average stay of 5 days. The frequency of hypertensive emergencies varies according to age, ethnic origin, and period studied. Black patients often suffer from more severe forms of high blood pressure, arising at an earlier age. Hypertensive encephalopathy can occur in patients with or without chronic hypertension. Without treatment, the encephalopathy induces a coma that can quickly become fatal. Its spontaneous course is catastrophic (10-20% survival at one year), but more favorable with adequate treatment (60-80% survival at five years).
Subject(s)
Hypertensive Encephalopathy/complications , Status Epilepticus/complications , Adult , Black People , Emergencies , Humans , Hypertensive Encephalopathy/diagnosis , Male , Middle Aged , Retrospective Studies , Status Epilepticus/diagnosisABSTRACT
OBJECTIVE: To study the epidemiological, clinical and evolutionary aspects of head trauma in children at the emergency room. METHOD: This was a descriptive longitudinal study over 1 year from February 2016 to February 2017, which included any patient aged 0 to 15 years who had cranial trauma The data were collected from a pre-established questionnaire, analyzed by the software (SPSS 22.0, EXCEL and WORD 2010).The chi-square test or Fisher's exact test was used for the statistical analysis, a value <0.5 considered significant. RESULTS: During the study period, 19825 consultations were performed at the emergency service of which 297 cranial trauma occurred in children, ie 1.5%. The male sex was predominant at 68% with a Sex ratio (H / F) = 2.13. The 6-10 age group was the most represented with 39.4%. The students were the most represented with 58.9%. Road accidents were the predominant mechanism of injury with 54.9%. Civil protection transported 29% of the wounded. The motorcycle-pedestrian mechanism was more frequent at 27.6% (n = 82). CT was severe in 17.8% (n = 53) of patients. The photomotor reflex was abnormal in 29% (n = 86). The trauma of the lower limb was associated in 39.3%. Craniosphalic CT with cervical scan was the most performed with 73.8%. The brain lesions were in the majority with 41.1%. The average care time was 9.82h in 54.2%. Exclusive medical treatment was adopted in 91.2% of cases. The tramadol and paracetamol combination was mainly used in analgesia with 78.1% of cases The evacuation of the hematoma was the most used surgical procedure with 65.4%. Hyperthermia was the most represented ACSOS (secondary cerebral aggression of systemic origin) with 6.7%. Death before care accounted for 5.4% (n = 16), hospital death at 12.8% (n = 38). The admission time to UE was 24-48h in 31.6% (n = 168). Prognostic factors were related to Motor Photo Reflex (p = 0.002), mechanism (p = 0.01), Glasgow score
OBJECTIF: Analyser l'aspect épidémioclinique et évolutif des traumatismes crâniens chez l'enfant au service d'accueil des urgences (SAU). MÉTHODE: Etude longitudinale descriptive sur 1 an qui a inclus tout patient âgé de 0 à 15 ans victime de TCE. Les données ont été recueillies à partir d'un questionnaire préétabli, analysées par les logiciels SPSS 22.0, EXCEL et WORD 2010, les tests (chi-carré, Fisher) ont été utilisés pour l'analyse statistique, une valeur < à 0,05 considérée comme significative. RÉSULTATS: 19825 ont été admis au SAU dont 9912 victimes de traumatismes, parmi lesquelles 297 TCE ont été diagnostiqués chez l'enfant soit 1,5%. Le sexe masculin a été prédominant à 68%. La tranche d'âge 6-10 ans a été la plus représentée 39,4%. Les élèves étaient les plus représentés avec 58,9%. Les accidents de la Voie publique ont été le mécanisme lésionnel le plus fréquent 54,9%.La protection civile a transporté 29% des blessés. Le mécanisme moto-piéton a été plus fréquent à 27,6% (n=82). Le TC était grave chez 17.8% (n=53). Le reflexe photomoteur était anormal chez 29% (n=86). Le traumatisme du membre inferieur était associé dans 39,3%. Le taux de réalisation de la TDM cranioencephalique avec balayage cervical a été de 73,8% et a objectivé des lésions cérébrales dans 41,1%.Le délai d'admission au SAU était 31.6% (n=168) entre 24-48h. Le délai de prise en charge chirurgicale moyenne était de 9,82h chez 54.2%. Le traitement médical exclusif a été adopté dans 91,2% des cas. L'association tramadol et paracétamol a été la plus utilisée en analgésie avec 78,1% des cas. Le geste chirurgical a représenté 8,8% à type d'évacuation de l'hématome avec 65,4%. L'hyperthermie était l'agression cérébrale secondaire d'origine systémique (ACSOS) la plus représentée avec 6,7%. Le décès avant soins a représenté 5.4% (n=16), le décès hospitalier était de 12.8% (n=38). Les facteurs pronostiques étaient le réflexe photo moteur (p=0,002), le mécanisme (p=0,01), le score de Glasgow < à 9 (p=0,003), le délai de prise en charge (p=0,002) et l'association d'au moins deux ACSOS. CONCLUSION: le TCE chez l'enfant demeure un véritable problème de santé publique responsable d'une morbimortalité élevée, la prise en charge des ACSOS en pré hospitalier diminuerait significativement cette morbimortalité.
ABSTRACT
INTRODUCTION: Traditional gold washing traumatism during traditional gold panningfalls within the scope of occupational accidents, which are common pathologies in developing countries such as Mali. Our work aimed to study traumatism during traditional gold panning. MATERIAL AND METHOD: A 1-year prospective study from November 2014 to November 2015 on the cases of traumatism during traditional gold washing (TOT) admitted to the emergency room(ER) of the University Hospital Gabriel Touré during the study period. Data were collected from outpatient visit records and medical charts. Data were collected on the survey sheets and analyzed with Epi-info version 7.1.1.0.fr software. Data entry was made with Windows 7 software. RESULTS: During the study period, 21,400 patients were admitted to the ER, of whom 445 patients were victims of traumatism, a frequency of 2.08% of all outpatient visits in the ER. The age group 21-40 years old was the most represented with 64.94% of the cases. The male gender was predominant with 77.08% of the cases with a sex ratio of 3.36. Mine landslides were the most common causality in 65.39% of the cases. Dorsal spine involvement was the most common with 41.80% of cases. Medullary vertebral fracture was the most frequent diagnosis with 43.82% of cases. In total, 79.55% of patients received medical treatment. Patients or were transferred to neurosurgery department in 58.20% of cases. CONCLUSION: Traumatism during traditional gold panning is common. Lesions most often fit in a context of polytraumatism. The rapidity of the diagnosis and management are crucial to the prognosis of the disease.
INTRODUCTION: Les traumatismes d'orpaillage traditionnel entrent dans le cadre des accidents de travail survenu au cours de l'orpaillage traditionnel fréquemment rencontrés dans certains pays en voie de développement comme le Mali. Nous avons entrepris cette étude dans le but d'étudier les traumatismes au cours de l'orpaillage traditionnel. MATÉRIEL ET MÉTHODE: Etude prospective sur un an, de novembre 2014 à novembre 2015 portant sur les cas des traumatismes au cours de l'orpaillage traditionnel (TOT) admis au service d'accueil et des urgences (SAU) pendant la période d'étude. Les données étaient recueillies à partir des registres de consultation, des dossiers médicaux. Les données ont été collectées sur les fiches d'enquête et analysées à partir du logiciel Epi-info version 7.1.1.0.fr. La saisie a été faite à partir du logiciel Windows 7. RÉSULTATS: Durant la période d'étude, 21400 patients ont été admis au SAU, parmi lesquels 445 patients étaient victimes des traumatismes soit une fréquence de 2,08% de l'ensemble des consultations du service. La tranche d'âge de 2140 ans a été la plus représentée avec 64,94% des cas. Le sexe masculin a été prédominant soit 77,08% des cas avec un sex ratio de 3,36 en faveur des hommes. Les éboulements de mine ont été l'étiologie la plus fréquente avec 65,39% des cas. L'atteinte dorsale était la plus fréquente avec 41,80% des cas. La fracture vertébro médullaire a été le diagnostic le plus fréquent avec 43,82% des cas. La majorité des patients soit 79,55% des cas ont reçu un traitement médical. La plupart des patients soit 58,20% des cas ont été transférés en neurochirurgie. CONCLUSION: Les traumatismes survenus au cours de l'orpaillage traditionnel sont fréquents. Les lésions s'intègrent le plus souvent dans un contexte de poly-traumatisme. La rapidité du diagnostic et de la prise en charge sont déterminants au pronostic de la maladie.
Subject(s)
Accidents, Occupational/statistics & numerical data , Gold , Mining , Occupational Injuries/epidemiology , Adolescent , Adult , Aged , Child , Child, Preschool , Emergency Service, Hospital/statistics & numerical data , Female , Hospitals, University/statistics & numerical data , Humans , Male , Mali/epidemiology , Middle Aged , Patient Acceptance of Health Care/statistics & numerical data , Young AdultABSTRACT
Cardiovascular disease is a global public health problem. The management of cardiovascular emergencies is urgent due to the immediate life-threat.. Indeed, cardiovascular emergencies are responsible for 12 million deaths a year worldwide. In sub-Saharan Africa, its prevalence and burden are still poorly understood. Our study aimed to determine the prevalence and etiologies of cardiovascular emergencies. MATERIAL AND METHODS: We conducted a 12-month prospective study from May 1st, 2014 to April 30th, 2015 at the Emergency Department of CHU Gabriel Touré, Bamako. It Included all patients aged ≥ 15 years old (y.o) hospitalized for cardiovascular emergency during the study period. The data were collected in a questionnaire and analyzed with EPI - info French version 6.04. RESULTS: During this study, we collected 510 cases of cardiovascular emergency from 21600 ER admission, a prevalence of 1.2%.The average age was 57.07y.o ± 17.17. The female gender predominated with 57.3% with a sex ratio of 0.7. Patients had a low socio-economic status in 62.6% with 33% cases of unemployment. .Patients arrived in a taxi in 71.2% of the cases and they came right at the onset of the symptoms between 8 P.M and 12 A.M.28.7%Dyspnea was the most frequent reason for consultation with 23.7%. High blood pressure (HTA) was the most common cardiovascular risk factor with 54 % (Table I).Stroke was the most common diagnosis with 51.4% followed by global heart failure (15.1%) and coronary syndrome (10.1%) (Table II). The overall mortality rate was 23.3% (Table III). CONCLUSION: The frequency and burden of cardiovascular emergencies are still underestimated due to the lack or scarcity of diagnostic tools.
Les maladies cardio-vasculaires constituent un problème de santé publique au niveau mondial et la prise en charge des urgences cardio-vasculaires (UCV) constitue une priorité car elles mettent en jeu le pronostic vital à court terme. En effet, ces dernières sont responsables de 12 millions de décès par an dans le monde. En Afrique sub-saharienne, leur prévalence et leur importance restent encore mal connues. Notre étude avait pour objet de déterminer la prévalence des urgences cardiovasculaires et leur nature. MATÉRIEL ET MÉTHODES: Il s'agissait d'une étude prospective sur 12 mois du 01 Mai 2014 au 30 Avril 2015 au service d'Accueil des Urgences du Chu Gabriel Touré Bamako. Incluant tout patient d'âge ≥ 15 ans reçupour une urgence cardio-vasculaire. Les données ont été colligées par le biais d'une fiche d'enquête, saisies et analysées avec les logiciels EPI info version française 6. 04. et EXCEL. RÉSULTATS: Durant l'étude nous avons colligé 510 cas d'urgence cardio-vasculaire sur un total de 21600 admis représentant une prévalence de 1,2%. La moyenne d'âge était de 57,07± 17,17 et le sexe féminin prédominait avec 57,3% avec un sex-ratio à 0,7. Les sans-emplois étaient majoritaires avec 33% et les patients présentant un niveau socio-économique faible prédominaient avec 62,6%. La majorité des patients étaient admis entre H 20 et H 24 du début des symptômes soit 28,7% et les taxis étaient le moyen de transport vers l'hôpital le plus représentatif avec 71,2%. La dyspnée était le premier motif de consultation avec 23,7%. L'hypertension artérielle (HTA) était le facteur de risque cardiovasculaire le plus fréquent avec 54 % (Tableau I) et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) étaient le diagnostic le plus fréquent avec 51,4% (Tableau II) suivit de l'insuffisance cardiaque globale (15.1%) Tableau II et du syndrome coronarien (10,1%) (Tableau II). Le taux de mortalité globale était de 23,3%(Tableau III). CONCLUSION: La fréquence et l'impact des urgences cardio-vasculaires est encore certainement sous-estimé du fait de l'absence ou de l'insuffisance d'outils diagnostic.
ABSTRACT
INTRODUCTION: The brachial plexus consists of the ventral twigs of the last four cervical nerves and the first thoracic nerve. It ensures the motor and sensitive innervations of the thoracic limb. AIM: Our goal was to describe the brachial plexus of the cervical region to the middle third of the arm. METHODOLOGY: We conducted a prospective study at the anatomy Laboratory of the Faculty of Medicine and Dentistry in Bamako from September 2016 to October 2017. We dissected the brachial plexus (PB) of 13 fresh adult corpses on both sides. The inclusion criteria were: Fresh adult corpses with cervical regions and brachial without scarring. The injected or scar-carrying corpses were not included in the cervical and brachial regions. RESULTS: Twenty-six brachial plexus of which 18 bp in men and 8 bp in women were dissected. The average age of the subjects was 42 years (extreme: 18 and 70 years). We noted nerve block variations in 3.8%, fascicular in 3.8% and late terminal in 73.1%. The involvement of the anterior branch of the fourth spinal nerve (C4) was found in 46.2%. CONCLUSION: The brachial plexus is the seat of many anatomical variations whose knowledge is indispensable to treat its lesions.
INTRODUCTION: Le plexus brachial est constitué des rameaux ventraux des quatre derniers nerfs cervicaux et du premier nerf thoracique. Il assure l'innervation motrice et sensitive du membre thoracique. BUT: Notre but était de décrire le plexus brachial de la région cervicale au tiers moyen du bras. MÉTHODE: nous avons réalisé une étude prospective au laboratoire d'anatomie de la Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie de Bamako de septembre 2016 à octobre 2017. Nous avons disséqué des deux côtés les plexus brachiaux (PB)de 13 cadavres frais d'adultes. Les critères d'inclusion étaient : cadavres frais d'adulte avec les régions cervicale et brachiale sans cicatrice. N'ont pas été inclus les cadavres injectés ou porteurs de cicatrice au niveau des régions cervicale et brachiale. RÉSULTATS: Vingt-six plexus brachiaux dont 18 PB chez les hommes et 8 PB chez les femmes ont été disséqués. L'âge moyen des sujets était de 42 ans (extrême : 18 et 70 ans). Nous avons noté des variations tronculaires dans 3,8%, fasciculaires dans 3,8% et en fin terminales dans 73,1%. La participation du rameau antérieur du quatrième nerf spinal cervical (C4) a été trouvée dans 46,2%. CONCLUSION: Le plexus brachial est le siège de nombreuses variations anatomiques dont la connaissance est indispensable pour traiter ses lésions.
ABSTRACT
INTRODUCTION: Following the progress made regarding anesthesia reanimation, caesarean have become a much safer procedure. However, factors of mobi-mortality are still numerous. The main objective of this study was to analyze the factors of morbi-mortality arising during a caesarean. PATIENT AND METHOD: A retrospective cross-sectional study was conducted from January 2007 to December 2011 in the gynecology-obstetric and anesthesia reanimation services of the Gabriel TOURE University Hospital. The analysis looked at the medical files of women undergoing a caesarean and hospitalized in the gynecology-obstetric and anesthesia reanimation services. Data analysis was carried out with SPSS.19 (Statistical Package for Social Sciences) and the Epiinfo.7 softwares. Chi2 tests were performed to compare frequencies where a value of p≤0.05 was considered statistically significant. RESULTS: 269 medical files were analysed. Mean age was of 28.46 ± 6.702. The most frequent peroperative morbidity factors were cardiovascular. Death rate was of 5.2%. The most frequent cause of these deaths was eclampsia. Factors influencing morbi-mortalities were iterative caesareans and urgency of the caesarean. The evacuated mothers had presented complications in 37.3% of cases. CONCLUSION: The caesarean is a procedure that is not sufficiently safe in our services and there are a lot of factors of mobi-mortality.
INTRODUCTION: La sécurité au cours de la césarienne est devenue très grande grâce aux progrès de l'anesthésie réanimation. Cependant les facteurs de mobi-mortalité sont nombreux. Le but de ce travail était d'étudier les facteurs de morbi-mortalité au cours de la césarienne. PATIENTES ET MÉTHODE: Il s'agissait d'une étude transversale rétrospective de janvier 2007 à décembre 2011 dans les services de gynéco-obstétrique et d'anesthésie réanimation du centre hospitalier universitaire Gabriel TOURE. Elle a porté sur les dossiers des parturientes césarisées et hospitalisées dans les services de gynéco-obstétrique et d'anesthésie réanimation. L'analyse des données a été faite à l'aide du logiciel SPSS.19 (Statistical package for Social Sciences) et l'Epiinfo.7. Le test de khi2 était utilisé pour comparer les fréquences avec une valeur de p ≤ 0,05 considérée comme significative. RÉSULTATS: Le nombre de dossiers analysés était de 269. L'âge moyen était de 28,46 ± 6,702. Les événements morbides per opératoires fréquents étaient cardio-vasculaires. Le taux de létalité était de 5,2 %. La cause la plus fréquente des décès était l'éclampsie. Les facteurs de morbi-mortalités retrouvés ont été la césarienne itérative, le contexte urgent de la césarienne. Les parturientes évacuées avaient présenté une complication dans 37,3% des cas. CONCLUSION: La césarienne est un acte qui n'est pas suffisamment sûr dans notre structure. Les facteurs de mobi-mortalité sont nombreux.
ABSTRACT
La sécurité au cours de la césarienne est devenue très grande grâce aux progrès de l'anesthésie réanimation.Cependant les facteurs de mobi-mortalité sont nombreux. Le but de ce travail était d'étudier les facteurs de morbi-mortalité au cours de la césarienne. Patientes et méthode : Il s'agissait d'une étude transversale rétrospective de janvier 2007 à décembre 2011 dans les services de gynéco-obstétrique et d'anesthésie réanimation du centre hospitalier universitaire Gabriel TOURE. Elle a porté sur les dossiers des parturientes césarisées et hospitalisées dans les services de gynéco-obstétrique et d'anesthésie réanimation. L'analyse des données a été faite à l'aide du logiciel SPSS.19 (Statistical package for Social Sciences) et l'Epiinfo.7. Le test de khi2était utilisé pour comparer les fréquences avec une valeur de p â¤0,05 considérée comme significative. Résultats : Le nombre de dossiers analysés était de 269. L'âge moyen était de 28,46 ± 6,702. Les événements morbides per opératoires fréquents étaient cardio-vasculaires. Le taux de létalité était de 5,2 %. La cause la plus fréquente des décès était l'éclampsie. Les facteurs de morbi-mortalités retrouvés ont été la césarienne itérative, le contexte urgent de la césarienne. Les parturientes évacuées avaient présenté une complication dans 37,3% des cas. Conclusion :La césarienne est un acte qui n'est pas suffisamment sûr dans notre structure. Les facteurs de mobi-mortalité sont nombreux
Subject(s)
Academic Medical Centers , Cesarean Section , Mali , Morbidity , ResuscitationABSTRACT
INTRODUCTION: Reanimation consists of the taking care of patients of all ages presenting or likely to present one or more acute failures directly affecting their likelihood of survival. According to the Society of Reanimation of the French Languages in 2012, in the United States 50% of the patients admitted in reanimation have more than 65 years whereas in France, the patients older than 80 years represent more than 10% of the admissions of the intensive care units. OBJECTIVE: To determine the reasons for admission of the elderly patients in reanimation of the Gabriel Touré teaching hospital. PATIENTS AND METHOD: A cross-sectional study was conducted from October 2010 to September 2011 in the Gabriel Touré teaching hospital of Bamako. Patients aged 65 year old and up were included. All patients were the subject of a meticulous clinical examination. Data graphing was done using Excel. The analysis of the data was made on the SPSS 17.0 software. The statistical test used was Chi2 with a significance fixed to P = 0, 05. RESULTS: During the period of study, the data of 95 elderly people was collected for 501 admissions (18.9%); the 65 to 74 years old age bracket represented 63.3% (figure 1). The sex-ratio was 1.4 in favour of men. Mental deterioration was the principal cause for admission in 65.3% of the cases. Cerebral vascular accidents were the most encountered pathology with 40.7% of cases. The most common noted prognosis was the likelihood of intervention complications. CONCLUSION: The most common admission factors were mental deterioration, respiratory distress syndrome. The prognosis is conservative considering the patients' old age, medical pathology, and a Glasgow score inferior to 8 at the time of admission.
INTRODUCTION: L'activité de réanimation consiste à la prise en charge des patients de tout âge présentant ou susceptible de présenter une ou plusieurs défaillances aigues mettant en jeu le pronostic vital. Selon la société de réanimation des langues françaises en 2012, aux Etats-Unis, 50% des patients admis en réanimation ont plus de 65 ans alors qu'en France, les patients de plus de 80 ans représentent plus de 10% du recrutement des services de réanimation. OBJECTIF: Etait de déterminer les motifs d'admissions des personnes âgées en réanimation du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. PATIENTS ET MÉTHODE: Il s'agissait d'une étude transversale d'octobre 2010 à septembre 2011 au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako. Les patients âgés de 65 ans et plus étaient inclus. Tous les patients ont fait l'objet d'un examen clinique minutieux. Les graphiques ont été réalisés à l'aide du logiciel Excel. L'analyse des données a été faite sur logiciel SPSS17.0. Le test statistique utilisé était le test de Chi2 avec un seuil de signification fixé à P ≤ 0,05. RÉSULTATS: Pendant la période d'étude 95 personnes âgées ont été colligées sur 501 admissions soit une fréquence de 18,9 %. La tranche d'âge de 65 à 74 ans était la plus représentée avec 63,3%. Le sex-ratio était de 1,4 en faveur des hommes. L'altération de la conscience était le principal motif d'admission dans 65,3% des cas. L'accident vasculaire cérébral était la pathologie médicale la plus rencontrée avec 40,7% des cas. Le facteur pronostique le plus marqué était la survenue des complications. CONCLUSION: Les signes à l''admissions les plus fréquents sont l'altération de la conscience, le syndrome de détresse respiratoire. Le pronostic est réservé en présence d'un âge plus avancé, d'une pathologie médicale, et d'un score de Glasgow inferieur à 8 à l'admission.
ABSTRACT
Introduction : Les traumatismes d'orpaillage traditionnel entrent dans le cadre des accidents de travail survenu au cours de l'orpaillage traditionnel fréquemment rencontrés dans certains pays en voie de développement comme le Mali. Nous avons entrepris cette étude dans le but d'étudier les traumatismes au cours de l'orpaillage traditionnel. Matériel et méthode : Etude prospective sur un an, de novembre 2014 à novembre 2015 portant sur les cas des traumatismes au cours de l'orpaillage traditionnel (TOT) admis au service d'accueil et des urgences (SAU) pendant la période d'étude. Les données étaient recueillies à partir des registres de consultation, des dossiers médicaux. Les données ont été collectées sur les fiches d'enquête et analysées à partir du logiciel Epi-info version 7.1.1.0.fr. La saisie a été faite à partir du logiciel Windows 7. Résultats : Durant la période d'étude, 21400 patients ont été admis au SAU, parmi lesquels 445 patients étaient victimes des traumatismes soit une fréquence de 2,08% de l'ensemble des consultations du service. La tranche d'âge de 21-40 ans a été la plus représentée avec 64,94% des cas. Le sexe masculin a été prédominant soit 77,08% des cas avec un sex ratio de 3,36 en faveur des hommes. Les éboulements de mine ont été l'étiologie la plus fréquente avec 65,39% des cas. L'atteinte dorsale était la plus fréquente avec 41,80% des cas. La fracture vertébro médullaire a été le diagnostic le plus fréquent avec 43,82% des cas. La majorité des patients soit 79,55% des cas ont reçu un traitement médical. La plupart des patients soit 58,20% des cas ont été transférés en neurochirurgie. Conclusion : Les traumatismes survenus au cours de l'orpaillage traditionnel sont fréquents. Les lésions s'intègrent le plus souvent dans un contexte de poly-traumatisme. La rapidité du diagnostic et de la prise en charge sont déterminants au pronostic de la maladie
Subject(s)
Academic Medical Centers , Health Care Economics and Organizations , Mali , Trauma, Nervous SystemSubject(s)
Connective Tissue/analysis , Lactones , Liver Neoplasms/chemically induced , Sarcoma, Experimental/chemically induced , Adenoma/chemically induced , Animals , Chemical Phenomena , Chemistry , Female , Lactones/analysis , Lactones/chemical synthesis , Liver/analysis , Lung Neoplasms/chemically induced , Male , Methylation , Mice , Microscopy, Fluorescence , RatsSubject(s)
Carcinogens , Naphthyridines , Benzopyrans , Chemical Phenomena , Chemistry , Ethers, Cyclic , Naphthalenes , Polycyclic Compounds , Pyridines , QuinolinesABSTRACT
The title compound, which belongs to a new synthetic group of polycyclic lactones derived from isocoumarin, exhibits a remarkably high degree of carcinogenicity in situ when injected in mice. Cancer-inducing activity has also been found in similar isocoumarins, a family known to include many naturally occurring substances.