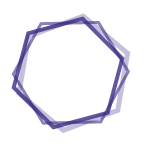ABSTRACT
Introduction: la crise vaso-occlusive (CVO) est la plus fréquente manifestation de la drépanocytose et la première cause d´hospitalisation des enfants atteints. L´objectif de cette étude est de décrire les aspects cliniques des CVO sévères, de déterminer les étiologies des syndromes infectieux qui les accompagnent et de décrire leur prise en charge. Méthodes: il s'agit d'une étude transversale descriptive portant sur 137 drépanocytaires majeurs hospitalisés pour CVO sévères du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 dans le service de pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. Résultats: les drépanocytaires homozygotes SS étaient les plus nombreux (n=98; 71,5%), suivis des doubles hétérozygotes SC (n=28; 20,5). Le délai moyen de consultation était de 4,7 ± 4,4 jours. Le traitement avant l´admission comportait des antibiotiques (28,5%). Les CVO étaient surtout ostéo-articulaires (70,8%). Dans 98,5% des cas, une infection bactérienne associée a été confirmée (48,9%) ou présumée (49,6%). Les principales étiologies étaient le syndrome thoracique aigu (26,3%), l´ostéomyélite aiguë (10,9%), l´infection urinaire (6,6%), la septicémie (3,6%). Un germe a été isolé chez 14,6% des patients, Escherichia coli (30%) étaient en tête suivi de Klebsiella pneumoniae (25%), Staphylococcus aureus (15%), Salmonella typhi (10%), Streptococcus pneumoniae (5%), le Streptocoque D (5%), l´Enterobacter (5%) et l´Acinetobacter (5%). Le taux de mortalité était de 2,2%. La durée moyenne d´hospitalisation était de 11,4 ± 8,8 jours. Conclusion: les CVO drépanocytaires sévères sont en majorité associées aux infections bactériennes en milieu tropical. Une antibiothérapie adaptée et précoce constitue le moyen thérapeutique indispensable pour prévenir ou traiter ces patients.
Introduction: vaso-occlusive crisis (VOC) is the most common manifestation of sickle cell disease and the leading cause of hospitalization among affected children. The purpose of this study is to describe the clinical features of severe VOCs, to determine the etiologies of infectious syndromes that accompany them and to describe their management. Methods: we conducted a descriptive cross-sectional study of 137 adult patients with sickle cell disease hospitalised for severe VOC in the Paediatric Department of the Sylvanus Olympio University Hospital from 1 January 2009 to 31 December 2011. Results: the majority of patients (n=98; 71.5%) had homozygous sickle cell (SS), followed by double heterozygous SC disease (n=28; 20.5). The median of consultation time was 4.7 ± 4.4 days. Treatment before admission was based on antibiotics (28.5%). VOCs were mainly osteoarticular (70.8%). In 98.5% of cases, an associated bacterial infection was confirmed (48.9%) or suspected (49.6%). The main etiologies included acute chest syndrome (26.3%), acute osteomyelitis (10.9%), urinary tract infection (6.6%) and septicaemia (3.6%). One germ was isolated from 14.6% of patients: Escherichia coli (30%), followed by Klebsiella pneumoniae (25%), Staphylococcus aureus (15%), Salmonella typhi (10%), Streptococcus pneumoniae (5%), Streptococcus D (5%), Enterobacter (5%) and Acinetobacter (5%). Mortality rate was 2.2%. The average length of stay in hospital was 11.4 ± 8.8 days. Conclusion: severe sickle cell related vaso-occlusive crisis is mainly associated with bacterial infections in tropical environments. Appropriate and early antibiotic therapy is the essential therapeutic means to prevent or treat these patients.
Subject(s)
Humans , Male , Female , Infant, Newborn , Infant , Child, Preschool , Child , Adolescent , Anemia, Sickle CellABSTRACT
As the search for, and development of new drugs continues, drug companies engage in the large-scale pharmacological screening of medicinal plants. This creates the need to elucidate the mechanism of action of medicinal plants found to possess biological activity as a means of deriving their full therapeutic potential. This research was carried out to investigate the mechanism of the antihypertensive action of Vernonia amygdalina, Ocimum gratissimum, and Pterocarpus erinaceus using animal models. The dried 70% ethanolic extracts of the plants were prepared at varying concentrations ranging from 0.4 mg/mL to 50 mg/mL. These extracts were administered at varying doses alone and in the presence of selected antagonists like prazocin in anesthetized cat in-vivo and to rabbit jejunum and spontaneously beating guinea pig right atrium. Adrenaline and atropine were used as control drugs.The effects of these plants extracts were demonstrated on the Finkleman preparation and they were found to induce relaxation of the rabbit jejunum. They also reduced both the rate and force of contraction of spontaneously beating guinea pig's right atrium. The cardiovascular effects of the extracts were investigated on cat blood pressure. The effect of atropine tested in the presence of V. amygdalina and O. gratissimum showed a change in the pattern of induced fall in blood pressure but does block the fall in blood pressure induced by the extracts. While the exact mechanism of the antihypertensive action of these extracts has not been fully determined, the result of this research work proposes that the mechanism could either be blocking calcium channels or have direct activity on lowering blood pressure. It is therefore recommended that further studies be conducted on the extracts to better understand the mechanism of antihypertensive actions of these plants.
Subject(s)
Humans , Animals , Rabbits , HypertensionABSTRACT
Introduction. Au Mali, le dépistage de certains virus tels que la dengue, Zika et la fièvre de la vallée du Rift n'est pas systématique au centre national de transfusion sanguine (CNTS). Le risque peut être considérable en raison de leurs courtes périodes de virémie asymptomatique dans la population dont l'incidence est variable et parfois extrêmement élevée. Cette étude avait pour objectif d'explorer la possibilité de transmission de certains arbovirus à travers le don de sang au CNTS de Bamako. Méthodes. Il s'agissait d'une étude transversale, de juillet 2019 à juin 2020 à Bamako. Au total deux cents (200) donneurs de sang du CNTS ont été inclus. Les examens ont été réalisés au Centre d'Infectiologie Charles Mérieux (CICM) de Bamako avec le dépistage du génome des virus responsables de la Dengue, de la fièvre de la Vallée du Rift, et du Zika à l'aide de la technique de la RT-PCR en temps réel. Le Test de Dépistage Rapide (TDR) a été utilisé pour la détection des anticorps IgG et IgM spécifiques de la Dengue. Résultats. Le sexe masculin représente 84% (168/200). Le TDR a détecté 4,5% (9/200) de Dengue IgG positifs et aucun cas de Dengue IgM positif. La technique de RT-PCR n'a détecté aucun des trois virus. Conclusion. Cette étude prouve que le risque de transmission de certains arbovirus à travers le don de sang existe, mais il semble être minime au CNTS de Bamako
Background. In Mali, screening for certain viruses such as dengue, Zika, and Rift Valley fever is not systematic at the national blood transfusion center (CNTS). The risk can be considerable due to their short periods of asymptomatic viremia in the population with variable and sometimes extremely high incidence. The objective of this study was to explore the possibility of transmission of certain arboviruses through blood donation at the CNTS of Bamako. Methods. This was a cross-sectional study, from July 2019 to June 2020 in Bamako. A total of two hundred (200) blood donors from the CNTS were included. The examinations were performed at the Centre d'Infectiologie Charles Mérieux (CICM) in Bamako with the screening of the genome of viruses responsible for Dengue, Rift Valley fever, and Zika using the real-time RT-PCR technique. The Rapid Screening Test (RST) was used for the detection of Dengue-specific IgG and IgM antibodies. Results. Male sex represented 84% (168/200). The RDT detected 4.5% (9/200) of IgG positive Dengue and no IgM positive Dengue cases. The RT-PCR technique did not detect any of the three viruses. Conclusion. This study proves that the risk of transmission of certain arboviruses through blood donation exists, but it seems to be minimal at the CNTS of Bamako.
Subject(s)
Humans , Male , Female , Arboviruses , Rift Valley Fever , Blood Donors , Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction , Dengue , Zika Virus , Polymerase Chain ReactionABSTRACT
Introduction : Les infections survenant chez les sujets diabétiques ont été longtemps considérées comme une des causes de l'accroissement de la morbidité et de la mortalité. Elles représentent un motif de plus en plus fréquent d'admission dans le service de médecine interne du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Thiès. Les mécanismes sont plus ou moins élucidés par l'influence de l'hyperglycémie sur les fonctions des polynucléaires neutrophiles. Le but de cette étude est de déterminer les particularités épidémiologiques des infections chez les diabétiques. Patients et Méthode : Il s'agissait d'une étude rétrospective avec recueil de données réalisée sur 24 mois (1er janvier 2016 au 31 décembre 2018) au service de Médecine Interne du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Thiès. Cette étude incluait tous les patients diabétiques quel que soit le genre et le type de diabète, âgés de 15 ans et plus, présentant une infection comme facteur principal de décompensation. Résultats : Durant la période d'étude 2350 patients ont été hospitalisés dans le service de médecine interne dont 390 diabétiques. Parmi eux, 138 patients ont répondu à nos critères d'inclusion soit une prévalence de 35,38%. La moyenne d'âge de nos malades était de 53,49 ans ± 15,65 ans avec un sex-ratio H/F était de 0,70 en faveur des femmes (81 femmes contre 57 hommes). Les infections responsables de la décompensation étaient à localisation cutanéo-muqueuse (30,4%), pulmonaire (22,4%), uro-génitale (18,11%), buccodentaire (10,11%), ORL (1,44%), phanérienne (0,72%). Ailleurs, une infection aux pieds était retrouvée chez 43 patients soit 31,15% des cas. Plusieurs infections pouvaient être présentes chez un même malade. Le diabète était déséquilibré dans 86,2 % (n=94) des cas avec une HbA1c moyenne à 10, 5 % à l'admission Nous n'avons pas noté de corrélation entre l'infection et l'ancienneté du diabète (p =0, 60), l'infection et le type de diabète (p = 0,50) et paradoxalement entre l'infection et le déséquilibre du diabète (p=0,70). Conclusion : Le dépistage des infections chez le diabétique en déséquilibre chronique ou diabétique de novo doit être systématique car généralement ces infections peuvent être asymptomatiques.
Introduction: Infections in people with diabetes have long been considered one of the causes of increased morbidity and mortality. They represent an increasingly frequent reason for admission to the Department of Internal Medicine of the Regional and University Hospital of Thies. The mechanisms are more or less elucidated by the influence of hyperglycemia on neutrophil polynuclear functions. The purpose of this study is to determine the epidemiological characteristics of infections in diabetics. Method: This was a retrospective study with data collected over 24 months (1 January 2016 to 31 December 2018) at the Internal Medicine Department of the Regional and University Hospital of Thies. This study included all diabetic patients, regardless of gender and type of diabetes, aged 15 years and older, with an infection as the primary decompensation factor. Result: During the study period 2,350 patients were hospitalized in the Internal Medicine Department, 390 of whom were diabetic. Of these, 138 patients met our inclusion criteria, a prevalence of 35.38%. The average age of our patients was 53.49 years 15.65 years with a sex-ratio H/F was 0.70 in favor of women (81 Women versus 57 Men). The infections responsible for decompensation were dermal localization (30.4%), pulmonary (22.4%), urogenital (18.11%), oral (10.11%), ENT (1.44%), phanerian (0.72%). Elsewhere, a foot infection was found in 43 patients or 31.15% of cases. Several infections could be present in the same patient. Diabetes was unbalanced in 86.2% (n=94) of cases with an average HbA1c of 10.5% at admission We did not find a correlation between the infection and the age of diabetes (p =0, 60), the infection and the type of diabetes (p = 0.50), and paradoxically between the infection and the imbalance of diabetes (p = 0.70). Conclusion: The detection of infections in diabetics in chronic imbalance or de novo diabetics must be systematic because generally these infections can be asymptomatic.
Subject(s)
Humans , Male , Female , Respiratory Tract Infections , Diabetes Complications , Diabetes Mellitus , Skin Diseases, Infectious , VaricoceleABSTRACT
This study was conducted to describe the distribution of precancerous and cancerous lesions of the cervix uteri, enumerated during a mass screening in Burkina Faso. We conducted a cross-sectional study involving 577 women aged 18 to 60 years, carried out from November 23 to December 19, 2013, in the city of Bobo-Dioulasso and in the rural commune of Bama. Regarding the screening results, 89 participants (15.4%) were positive for pre-malignant cervical lesions. Chi-square testing and logistic regression analyses were conducted to identify the likelihood of cervical pre-cancer lesion in the women. Participants less than 29 years old were approximately 3 times more likely to have cervical lesions than participants >39 years. Participants who were parous (1-3 deliveries) and multiparous (four or more deliveries) were approximately 4 times more likely to present with cervical lesions than nulliparous women. Access to screening services is low in the Bobo-Dioulasso region. Further research should be conducted to understand the incidence and distribution of cervical precancerous and cancerous lesions in Burkina Faso. (Afr J Reprod Health 2022; 26[6]:97-103).
Subject(s)
Humans , Female , Uterine Cervical Neoplasms , Acetic Acid , Precancerous Conditions , Uterine Neoplasms , Early Detection of CancerABSTRACT
Aim: To assess the COVID-19 patients' treatment duration according to the place of treatment at the Dermatology Hospital of Bamako (DHB). Methods: This was a cross-sectional study comparing the management of COVID-19 PCR-positive patients in the hospital to that of those managed at home from March 2020 to April 2021 until two consecutive negative PCR 48 hours apart. Results: Among the 1109 patients, 369 were hospitalized, 497 followed at home. As of April 31, 2021, 81.2% (900/1109) of the patients recovered, 1.3% (14/1109) were transferred to another health structure, and 2.5% (28/1109) died. No statisticallysignificant difference was observed between the meanduration of the treatment for patients treated at home (10 days) in (95% CI, 9.69-10.3) and those managedathospital (10 days95% CI, 9.76-10.23) (Mantel-Cox test, p= 0.060). Conclusion: These results suggest that the place of treatment do not influence the time to recovery. This is particularly important given the current burden of COVID-19 management on the health workforce
Objectif: Evaluer la durée du traitement des patients COVID-19 selon le lieu de pris en charge à l'Hôpital de Dermatologie de Bamako (HDB). Méthodologie : Il s'agissait d'une étude transversale comparant la prise en charge des patients COVID-19 PCR-positifs à l'hôpital à celle à domicile de mars 2020 à avril 2021 jusqu'à l'obtention de deux tests PCR négatifs consécutifs à 48 heures d'intervalle. Résultats : Parmi les 1109 patients, 369 ont été hospitalisés, 497 suivis à domicile. Au 31 avril 2021, 81,2% (900/1109) des patients se sont rétablis, 1,3% (14/1109) ont été transférés dans une autre structure de santé et 2,5% (28/1109) sont décédés. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre la durée moyenne du traitement pour les patients traités à domicile (10 jours) en (IC 95 %, 9,69-10,3) et ceux pris en charge à l'hôpital (10 jours IC 95 %, 9,76-10,23) (test de Mantel Cox, p= 0,060). Conclusion: Ces résultats suggèrent que le lieu de traitement n'influence pas le temps de récupération. Ceci est particulièrement important étant donné la charge actuelle de la gestion des COVID-19 sur le personnel de santé
Subject(s)
Dermatology , Duration of Therapy , COVID-19 , Recovery Room , HospitalsABSTRACT
Objective: To determine maternal and neonatal complications occurring at childbirth among adolescents.Materials and methods: This is a retrospective, descriptive study conducted from 1st July to 31st December 2019 at the maternity ward of the Sylvanus Olympio University Hospital Centre (CHU- SO), Lomé, Togo. The socio- demographic parameters of the mothers, details of prenatal and perinatal events and the clinical profile of the newborns at birth were studied. Results: The records of 332 adolescent mothers were studied. The average age of the mothers was 17.4 ± 1.5 years, with a range of 13-19 years. The pregnancies in two-thirds (66.3%) were supervised in centres without surgical facilities and by midwives in 83.1% of cases. A little over half of the mothers (53.3%) attended at least four antenatal clinic sessions, while 3.6% attended none. The modes of delivery were spontaneous vaginal (62.3%) and Caesarean section (35.2%). Complications of pregnancy were recorded in 12.9% of the mothers. There were statistically significant associations between the referred status of the mothers and haemorrhages, retained placenta and sepsis (p = 0.001, 0.038 and 0.011, respectively). There were no maternal deaths. The newborn babies required resuscitation in 6.3% of cases, while 7.0% were stillborn.There was a statistically significant relationship between the referred status of mothers and the occurrence of perinatal deaths (p =0.0001). Conclusion: Adolescent mothers are at risk of complications during childbirth, and these risks are increased by poor antenatal care and attempted deliveries in centres without surgical facilities.
Subject(s)
Humans , Adolescent , Perinatal Death , Asphyxia Neonatorum , Sexual HealthABSTRACT
Introduction. L'âge maternel ne cesse de reculer ces derniers années.Le but était d'étudier le pronostic de l'accouchement chez les gestantes de 35 ans et plus à l' l'hôpital Fousseyni Daou de Kayes. Méthodologie. Il s'agissait d'une étude descriptive à collecte prospective Castémoins qui a concerné la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Lescas étaient constitués par toutes les gestantes de 35 ans et plus ayant accouché à la maternité et lestémoins par toutes les gestantes de 20-30 ans ayant accouché à la maternité. Résultat. Durant nôtre étude nous avons enregistré 260 accouchements chez les gestantes ayant un âge supérieur ou égal 35 ans sur un total de de 4127 accouchements réalisés soit une fréquence de 6,3%.L'âge moyen chez les cas était de 38ans contre 24 ans chez les témoins. 65,4% de cas ont accouché par voie basse contre 68,8% chez les témoins. La césarienne a été réalisée chez 32,3% des contre 30% chez les témoins. Les principales complications retrouvées ont été l'hémorragie du post-partum, la déchirure périnéale, la déchirure cervicale et la mortalité maternelle. Chez les cas 79% des nouveau-nés avaient un score d'APGAR supérieur à 7 contre 88,8% chez les témoins. Conclusion. L'accouchement chez les gestantes de 53 ans et plus est fréquent dans nôtre service. Les complications obstétricales augmentent avec l'âge maternel et sont très fréquentes au cours de cette période
Subject(s)
Humans , Parturition , Hospitals , Prognosis , Pregnant WomenABSTRACT
Introduction: La coronarographie est une méthode exploratrice et thérapeutique des artères coronaires qui connait depuis quelques années des avancées remarquables, de telle sorte que ses indications peuvent s'étendre à tous les âges en fonction des orientations cliniques. L'objectif de ce travail était de décrire les aspects des artères coronaires chez les patients de moins de 40 ans explorés au CHU Aristide Le Dantec.Patients et Méthodes: Nous avons effectué une étude descriptive qui incluait tous les patients dont l'âge était inférieur ou égal à 40 ans et qui avaient eu une coronarographie suite à un consentement éclairé dans la période du 1er Mai 2014 au 31 Août 2017. Les paramètres étudiés étaient épidémiologiques, cliniques, coronarographique, incluant l'éventuelle angioplastie Résultats: Nous avions inclus 32 patients. L'âge moyen était de 33,84 ± 5,59 ans, avec un minimum de 18 ans. Le genre masculin prédominait avec 27 hommes. Le facteur de risque cardio-vasculaire le plus fréquemment retrouvé était le tabac (28,13%) suivi de la dyslipidémie (25%), de l'hérédité (18,75%) et du surpoids (15,6%). Chez deux patients (6,25%), on a noté une consommation de substance stupéfiante. Les indications de la coronarographie étaient entre autres, le syndrome coronaire aigu (72%) et l'angor d'effort à (19%). La coronarographie était normale chez 11 patients et Pathologique chez les 21 restants, incluant 15 cas (46,87%) avec des lésions serrées. Les atteintes angiographiquement significatives étaient dominées par les atteintes mono-tronculaires dans 50% des cas. L'angioplastie était réalisée avec satisfaction chez 5 patients avec une prédominance de stents nus.Conclusion : Chez le sujet jeune avec syndrome coronarien aigu ou angor d'effort, le facteur de risque le plus fréquent est le tabac et l'atteinte coronaire est le plus souvent mono tronculaire
Subject(s)
Coronary Angiography , Coronary Artery Disease , SenegalABSTRACT
INTRODUCTION: La santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé générale et du bien-être de tous les individus selon l'OMS. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'état buccodentaire des patients vus en consultation dans le service d'Odontostomatologie du Centre de Santé de Référence de Ouelessebougou au MALI. MÉTHODOLOGIE: Il s'agissait d'une étude prospective, transversale de type descriptif d' une période de 3 mois allant du 01 Août au 30 octobre 2018.L'étude portait sur tous les patients venus en première consultation dans le service. RÉSULTATS: Dans cette étude, le sexe masculin représentait 52% des cas avec un sex ratio de 1,08 %. La tranche d'âge la plus représentée était celle de 16 à 30 ans avec 53,25 %. La moyenne d'âge était de 30 ans. Parmi les pathologies bucco-dentaires, la carie dentaire était la plus représentée avec 94,14 % suivie des affections parodontales avec 71,82%. Cette étude a montré que 79 % des patients se brossaient les dents. Parmi les 122 patients qui se brossaient, 41,80% se brossaient 1 fois par jour, et 45,80% se brossaient 2 fois par jour. La méthode horizontale traumatisante était la plus présentée avec 78,68 %. Selon cette étude, 91% des patients avaient besoin d'enseignement de l'Hygiène Bucco-dentaire. CONCLUSION: Devant cette situation, une nouvelle orientation de la politique de santé bucco-dentaire basée sur l'odontologie préventive s'impose afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des populations
INTRODUCTION: Oral health is an integral part of the overall health and well-being of all people according to the WHO. The objective of this study was to evaluate the oral status of patients seen in consultation in the Odonto-stomatology Department of the Ouelessebougou Reference Health Center in MALI. METHODOLOGY: This was a prospective, cross-sectional descriptive study of a 3-month period from August 1st to October 30th, 2018. The study included all the patients who had come for first consultation in the department. RESULTS: In this study, males accounted for 52% of cases with a sex ratio of 1.08%. The most represented age group was 16 to 30 years old with 53.25%. The average age was 30 years old. Among dental pathologies, tooth decay was the most represented with 94.14% followed by periodontal disease with 71.82%. This study showed that 79% of patients brushed their teeth. Of the 122 patients who brushed, 41.80% brushed once a day, and 45.80% brushed twice a day. The traumatic horizontal method was the most presented with 78.68%. According to this study, 91% of patients needed oral hygiene education. CONCLUSION: Given this situation, a new orientation of oral health policy based on preventive dentistry is needed to improve the health and quality of life of populations
Subject(s)
Dental Caries , Mali , Oral Hygiene , Patients , Periodontal Diseases , PrevalenceABSTRACT
Introduction:Les violences sexuelles constituent un problème de santé dont la prise en charge doitêtre adéquate et globale. Une stratégie préventive doit être menée afin de dissuader les potentielsagresseurs. Le but de l'étude étaitde décrire les cas de violences sexuelles reçus dans le Département de gynécoobstétrique du Centre Hospitalier Universitaire YalgadoOuédraogo (CHUYO).Patientes et méthode:Il s'est agi d'une étude rétrospective àvisée descriptive couvrant une période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.L'étude a concerné les présumées victimes de violences sexuelles reçues dans le département de gynécologie obstétrique du CHUYO et dont les dossiers étaient exploitables.Résultats: Lamoyenne d'âge des présumées victimes était de 16 ans avec des extrêmes allant de 03 ans à 32 ans. Le viol était le motif de consultation le plus fréquent (93,1%) et se déroulait nuitamment, généralement dans les domiciles.La lésion génitale la plus fréquente était les déchiruresvulvaires(17,8%). La lésion non gynécologique la plus fréquente était les égratignures (10,9%).La prise à charge des victimes était essentiellement médico chirurgicale.Le pronostic à court terme était favorable(100%). La prise en charge psychologique était marginale.Conclusion:Les violences sexuelles restent une préoccupation bien que sa fréquence soit faible. Ce fléau touche essentiellement les adolescentes
Subject(s)
Burkina Faso , Wounds and InjuriesABSTRACT
Le tatouage gingival est une pratique traditionnelle consistant à une pigmentation artificielle de la gencive rose en noire-grise.L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence et le niveau de perception du tatouage gingival chez les femmes venues en consultation dans le service d'odontologie de l'Infirmerie Hôpital de Bamako (Mali).Méthodologie:Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive d'une durée de 3 mois allant du 01 janvier au 31 mars 2018. La collecte des données a été faite sur la base d'une fiche d'enquête élaborée à cet effet en fonction des objectifs de l'étude. Les variables étudiées sont les données épidémiologiques et culturelles. Les données ont été traitées par le logiciel épi-info version 3.5.3.Résultats:Dans cette étude, la prévalence du tatouage gingival était de69,43%.La tranche d'âge la plus représentée était celle de 26-35 ans, suivie de cellede 4655 ans. La localisation au maxillaire seul représentait 90,16% suivi de la localization maxillaire et mandibulaire dans 06,33%.Les peulhs représentaient 39,58% suiviedes Sarakolés dans 32,55%.Selon cette étude, 65, 11% pensaient que le tatouage gingival est jolie (bon).Conclusion:En plus du côté esthétique créé par le contraste des effets de la couleur grise-noire de la gencive avec le blanc-laiteux des dents, le tatouage gingival est souvent utilisé dans le traitement traditionnel des parodontopathies
Subject(s)
Culture , Epidemiology , Gingiva , Mali , TattooingABSTRACT
Objectifs : décrire les anomalies associées aux holoprosencéphalies suspectées lors de l'échographie anténatale. Patients et méthodes. Il s'est agi d'une étude transversale descriptive. Nous avons inclus de façon consécutive, les cas suspects d'holoprosencéphalies diagnostiqués au cours d'échographies anténatales évolutives réalisées dans notre centre d'imagerie, entre janvier 2016 et décembre 2018, quel que soit l'âge gestationnel. Résultats : 11 cas suspects d'holoprosencéphalies ont été identifiés. Il s'agissait de formes alobaires dans huit cas et de forme semi lobaire dans trois cas. L'âge gestationnel médian lors du diagnostic était de 31 semaines d'aménorrhée [13 et 38 ans]. L'âge maternel médian était de 32 ans [23-41ans]. Il n'y avait pas de diabète maternel ou d'antécédent familial noté chez ces patientes. Les anomalies encéphaliques à type d'absence de la ligne médiane, de ventricules unique et de fusions des thalami étaient notées chez tous les foetus. Les anomalies nasales étaient présentes dans 8 cas /11, labiales dans 2 cas/11 et oculaires dans 5 cas/11. Les foetus étaient majoritairement de type féminin. On notait la présence d'autres anomalies dans 5 cas/11. Il s'agissait de néphropathie, d'anomalie fémorale et d'une communication interventriculaire. Conclusion : Malformation rare, l'holoprosencéphalie est diagnostiquée tardivement dans notre contexte. Il n'y avait pas de facteur étiopathogénique retrouvé. Les tests génétiques et l'étude du caryotype n'étaient pas disponibles dans notre contexte au cours de l'étude
Subject(s)
Burkina Faso , Congenital Abnormalities/diagnosis , Fourth Ventricle , Third Ventricle , Ultrasonography, PrenatalABSTRACT
Objectif : Décrire les aspects radiologiques et histopathologiques des tumeurs malignes mammaires chez la femme au Burkina Faso. Matériels et méthodes : étude transversale analytique à collecte rétrospective réalisée de janvier 2014 à octobre 2017. Les patientes incluses ont eu une microbiopsie mammaire sous guidage échographique après une exploration mammographique et échographique, avec un résultat histopathologique de malignité. Les variables recueillies étaient l'âge, les antécédents, la taille des nodules, la classification ACR et le diagnostic anatomopathologique. Résultats : l'échantillon de lésions malignes étaient constitué de 173 nodules. L'âge moyen était de 49.15 ± 11.55 ans et la taille moyenne des lésions de 31.57 ± 18.21mm. Les femmes de moins de 40 ans représentaient 16,8% de l'échantillon. Les antécédents familiaux étaient connus dans 7% des cas. A l'imagerie, on notait 4,05% de lésions classées ACR3, 68,79% de lésions ACR4 et 27,17% de nodules ACR5. Les tumeurs malignes étaient constituées essentiellement de carcinomes canalaires infiltrants dans 98,26 %. Conclusion. Le cancer du sein est mis en évidence chez la femme de la cinquantaine. Les nodules ont une tendance à la bénignité chez les femmes jeunes. La taille moyenne de la lésion est importante au moment du diagnostic
Subject(s)
Breast Neoplasms/diagnosis , Burkina Faso , Patients , WomenABSTRACT
Introduction : La localisation orbito-palpéral du neurofibrome plexiforme dans la maladie de Von Recklinghausen est rare. Nous en rapportons 8 cas. Patients et Méthode : Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive portant sur les dossiers de patients chez qui un diagnostic clinique et paraclinique de neurofibrome plexiforme palpébro-orbitaire était posé et pris en charge dans les services de Dermatologie-Vénérologie, d'Ophtalmologie et de Neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de 2005 à 2018. Résultats : Caracté-ristiques épidémiologiques : huit dossiers étaient colligés. Cinq patients étaient de sexe féminin et 3 de sexe masculin. Leur âge moyen était de 15,8 ans. Caractéristiques cliniques : Les atteintes cutanées de la maladie de Von Recklinghausen étaient des taches café au lait, des neurofibromes dermiques, le neurofibrome plexiforme orbito-palpébral unilatéral. L'examenophtalmologique retrouvait une gêne oculaire chez tous les patients, un ptosis, et une exophtalmie chez 2 patients. Un patient présentait un glaucome congénital. Trois patients présen-taient des nodules de Lisch, et un, une périsclérite. Une kérato-uvéite était retrouvée chez deux autres patients. Caractéristiques paracliniques : La tomodensitométrie montrait une atteinte osseuse (sphénoïdal et ou eth-moïdal, et ou du sinus maxillaire) chez tous les patients. L'IRM objectivait la tumeur plexiforme non encapsulé, infiltrant le tissu adipeux intra et extra conal, sans lésion du parenchyme cérébral. L'étude histologique confirmait le diagnostic de névrome plexiforme. Caractéristiques thérapeutiques et évolutives : La prise en charge était multidisciplinaire avec une exérèse chirurgicale à but fonctionnel et esthétique. L'évolution était favorable à court terme chez tous les patients. Une récidive chez un patient a nécessité une reprise chirurgicale qui s'est soldée par une rétraction de la fente palpé-brale, un ptérigion, un symblépharon, une kérato-uvéite et une chéloïde de l'angle extern
Subject(s)
Burkina Faso , Neurofibromatosis 1/diagnosis , Patients , Tomography, X-Ray ComputedABSTRACT
Les accidents du travail (AT) sont fréquents et s'accompagnent souvent de lourdes conséquences pour l'individu, la communauté et l'employeur, occasionnant dans certains cas des séquelles dont il faut déterminer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP). L'étude était transversale et analytique. Elle s'est déroulée sur une période de cinq années allant de 2012 à 2016, et a concerné tous les dossiers complets d'accidents du travail avec Incapacité Permanente Partielle AT/IPP enregistrés à la Direction régionale de Ouagadougou de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Les résultats descriptifs ont été présentés sous forme univariée et bivariée. L'échantillon était constitué de 221 cas d'AT/IPP extraits parmi les dossiers d'AT déclarés à Ouagadougou, soit un taux de 4,49 % (221/4922). L'échantillon était constitué de 54 femmes (24,4 3%) et 167 hommes (75,57 %). L'âge moyen était de 40,09 ± 8,8 ans (16 - 62 ans), avec une sinistralité plus fréquente dans le secteur des « services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels » (38,46 %). Plus de 2/3 des cas étaient des « employés » (67,42 %). Les accidents de trajet constituaient la majorité des sinistres (62 %). Ils survenaient en matinée entre 6 heures et 8 heures (45,25 %) et le véhicule de transport était le principal élément agent matériel causal (64,71 %). Les AT/IPP ont causé des fractures des membres (48,88 %) et entrainé 110 cas d'impotence fonctionnelle (49 %) et en moyenne 103 journées de travail perdues (3 - 848 jours). La prévention des AT/IPP devra intégrer des modules sur la sécurité routière
Subject(s)
Accidents, Occupational/prevention & control , Accidents, Occupational/statistics & numerical data , Accidents, Traffic , Burkina Faso , Fracture Dislocation , Professional Impairment , Social SecurityABSTRACT
Dans le monde du travail, l'alcoolisation de certains travailleurs est une préoccupation aussi bien de l'employeur que des autres salariés. En effet, l'alcool est un facteur démultiplicateur du risque professionnel. Cependant très peu de données sont disponibles dans les pays de la sous-région. L'objectif était d'étudier l'ampleur de la consommation d'alcool chez les travailleurs à Ouagadougou. Nous avons procédé à un échantillonnage stratifié simple. Le questionnaire AUDIT a été administré aux travailleurs ayant donné leur consentement. Les résultats ont été présentés sous formes univariées. L'échantillon était constitué de 350 travailleurs avec un taux de participation de 100 %. La prévalence de la consommation d'alcool était de 65,14 % avec une fréquence de consommation inférieure ou égale à 4 fois par mois chez 50 % des travailleurs. La quantité d'alcool consommée un jour typique de consommation était inférieure ou égale à 4 verres chez 57,02 %. Les travailleurs qui avaient une consommation à faible risque étaient les plus représentés avec 39,43 %. Le sexe masculin, la confession religieuse non musulmane et le niveau d'instruction supérieur étaient les facteurs associés à la consommation d'alcool chez les travailleurs. La consommation d'alcool chez les travailleurs dans la ville de Ouagadougou est importante. Cela interpelle les acteurs de la prévention quant à la nécessité d'en tenir compte dans la politique santé et sécurité au travail en entreprise
Subject(s)
Alcohol Drinking/epidemiology , Alcohol Drinking/prevention & control , Alcohol Drinking/trends , Burkina FasoABSTRACT
L'objectif était d'étudier les différents aspects de la rupture prématurée des membranes dans un contexte de pays à ressources limitées. Il s'est agi d'une étude prospective et descriptive à visée analytique, sur une période de 12 mois, dans le département de Gynécologie, d'Obstétrique et de Médecine de la Reproduction du Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Elle a concerné les gestantes reçues dans notre département chez qui le diagnostic de rupture prématurée des membranes (RPM), sur des grossesses de 28 à 34 semaines d'aménorrhée, a été confirmé à l'issue de l'examen clinique. Nous avons enregistré 38 cas de rupture prématurée des membranes pour 5024 accouchements soit une fréquence de 0,75 %. Ces gestantes étaient surtout jeunes, primipares, femmes au foyer, non alphabétisées, ayant fait peu de consultations prénatales. Les antécédents de ces patientes ont été marqués par des cas de ruptures prématurées des membranes et d'avortement. Ces patientes présentaient en outre soit des infections urogénitales, des présentations irrégulières, des distensions utérines et/ ou un placenta prævia. Cela nous a permis ainsi d'identifier un groupe de femmes que l'on pourrait dans une certaine mesure qualifier de groupe à risque de rupture prématurée des membranes dans notre département. La présence de certains éléments cliniques et paracliniques chez ces patientes, nous a permis d'identifier ce qu'on pourrait appeler des femmes à risque de rupture prématurée des membranes
Subject(s)
Academic Medical Centers , Amenorrhea , Burkina Faso , Fetal Membranes, Premature Rupture , Office Visits , Pregnancy Trimester, Third , Risk FactorsABSTRACT
Nous rapportons un cas de découverte fortuite chez une patiente de 26 ans, reçue pour douleurs abdomino-pelviennes sur grossesse présumée gémellaire de 33 SA. Aucune échographie obstétricale n'avait été réalisée avant son admission. Deux échographies tardives ont objectivé une grossesse gémellaire intra utérine avec hydramnios. Une césarienne à 36 semaines indiquée pour grossesse gémellaire avec hydramnios et anémie sévère a été réalisée au cours de laquelle nous avons découvert une grossesse intra-utérine et une grossesse abdominale avec insertion du placenta au niveau du ligament large gauche avec adhérence sur l'annexe gauche, l'épiploon et les anses grêles.Les nouveau-nés étaient bien portant. J1 intra utérin avait un poids de 2650 g et J2 abdominal de 2000g. Les suites ont été simples
Subject(s)
Burkina Faso , Diagnosis , Pregnancy, Heterotopic , PrognosisABSTRACT
The low rate of screening for hepatitis B virus (HBV) in pregnant women is a highrisk factor for its vertical transmission. The objectives of this study were: i) to screen pregnant women for HBV infection; ii) vaccinate all children from birth against HBV regardless their mother HBV status; and iii) evaluate after 7 months of birth the level of their AbHBs among babies who received HBV vaccine at birth. Serological markers of HBV (HBsAg, HBeAg, AbHBs, AbHBe, and AbHBc) were determined on venous blood samples from 237 pregnant women and their children using the Abon Biopharm Kit. One hundred and two (102) children received the three doses of the EUVAX B® vaccine respectively at birth, two months and four months of life. Seven months after delivery, venous blood samples were collected from mothers and their children. Antibodies against hepatitis B surface antigen (AbHBs) were measured in vaccinated children using the ELISA Kit AbHBs Quantitative EIA. DNA extraction was performed on samples from HBV-seropositive mothers and their children using the Ribo Virus (HBV Real-TM Qual) Kit and for Real Time PCR, the HBV Real-TM Qual Kit was used. Serological diagnosis in pregnant women revealed 22 (9.28%) hepatitis B surface antigen (HBsAg) positive samples of which 21 were positive for viral DNA by real-time PCR. Among the 22 HBsAg+ women, five (05) transmitted the virus to their children with a vertical transmission rate of 22.73%. A transmission rate of 23.81% (5/21) was found with the PCR method. Analysis of AbHBs levels revealed that 98.31% of the children had an average concentration of 218.07 ± 74.66 IU/L, which is well above the minimum threshold for protection (11 IU/L). This study has confirmed that vertical transmission of HBV is a reality in Burkina Faso and that vaccination at birth would significantly reduce this transmission