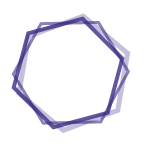ABSTRACT
Contexte et objectifs : L'accès aux tests neurophysiologiques pour le diagnostic des Troubles du Sommeil (TS) est très limité dans les pays d'Afrique subsaharienne. La présente étude avait pour objectif de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et neurophysiologiques des (TS) dans un groupe de jeunes adultes. Méthodes : Il s'est agi d'une étude descriptive d'une série de cas, réalisée au centre de Médecine du sommeil et des maladies respiratoires de l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon du 1er janvier au 31 mars 2019. Les patients hospitalisés pendant cette période pour l'exploration d'un (TS) ont été sélectionnés. Etaient éligibles ceux dont l'âge était compris entre 18 et 35 ans, des deux sexes, ayant renseigné un questionnaire et ayant bénéficié au minimum d'une polysomnographie (PSG). Résultats : Quatre-vingt-onze patients étaient examinés. Les femmes étaient les plus affectées (59,3 %). Leur âge moyen était de 26,6 ± 5 ans. La PSG a incriminé le Syndrome d'Apnée Hypopnée Obstructive du sommeil (SAHOS) comme étiologie principale (66 %). Pour les patients sans SAHOS, 38,7 % avaient une PSG normale et la PSG avec d'autres tests de sommeil ont objectivé, pour le reste (61,3 %), d'autres types de (TS). La dépression (50,7 %) et la fatigue chronique (84,6 %) étaient très fréquentes. L'indice d'efficacité du sommeil était faible pour 70 % des patients avec SAHOS. Il y avait un déséquilibre de la durée des stades du sommeil, augmentée pour le sommeil lent léger et diminuée pour le sommeil lent profond dans la population avec SAHOS, tandis que la durée du sommeil paradoxal chez ceux sans SAHOS était augmentée. Conclusion Le SAHOS est fréquent dans cette formation hospitalière, avec des répercussions significatives à type de dépression et de fatigue chronique. Il est important que des mesures rendant accessible l'usage des tests d'exploration du sommeil particulièrement en Afrique au sud du Sahara, soient mises en place pour diagnostiquer ces troubles
Context and objective. Access to neurophysiological tests for diagnostic of sleep disorders (SD) is very limited in Sub-Saharan Africa countries. The objective was to determine the epidemiological, clinical and neurophysiological characteristics of SD in a young adult group. Methods. This was a descriptive serial cases study carried out at the Sleep Medicine and Respiratory Diseases Center of the CroixRousse hospital of Lyon between January 1st and March 31th, 2019. Patients hospitalized during this period with tests for SD were selected. Eligible were those aged between 18 and 35 years, both sexes, who completed a questionnaire and who received at least a polysomnography (PSG). Results. Ninety-one patients were involved. Women remained the most affected (59.3%). Mean age was 26.6±5 years. PSG incriminated obstructive sleep apnea (OSA) syndrome as the primary etiology (66%). For patients without OSA, 38.7% had normal PSG. For the remaining 61.3% of patients, other types of SD were found using PSG with various sleep tests. Depression (50.7%) was an important comorbidity, and chronic fatigue (84.6%) was the most frequent complaint. Sleep efficiency index was low for 70% of sleep apnea patients. There was an imbalance in the duration of sleep stages, with an increase in light slow-wave sleep in the OSA population and a decrease in their deep slow-wave sleep, while REM sleep duration in patients without OSA was increased. Conclusion: OSA was the primary etiology in our study, with significant repercussions like depression and chronic fatigue. Public health measures such as increasing access to the use of sleep exploration tests, especially in subSaharan Africa, should be put in place for the diagnosis of these sleep disorders and their consequences
Subject(s)
Humans , Male , Female , Adult , Young AdultABSTRACT
Introduction : Les infections survenant chez les sujets diabétiques ont été longtemps considérées comme une des causes de l'accroissement de la morbidité et de la mortalité. Elles représentent un motif de plus en plus fréquent d'admission dans le service de médecine interne du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Thiès. Les mécanismes sont plus ou moins élucidés par l'influence de l'hyperglycémie sur les fonctions des polynucléaires neutrophiles. Le but de cette étude est de déterminer les particularités épidémiologiques des infections chez les diabétiques. Patients et Méthode : Il s'agissait d'une étude rétrospective avec recueil de données réalisée sur 24 mois (1er janvier 2016 au 31 décembre 2018) au service de Médecine Interne du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Thiès. Cette étude incluait tous les patients diabétiques quel que soit le genre et le type de diabète, âgés de 15 ans et plus, présentant une infection comme facteur principal de décompensation. Résultats : Durant la période d'étude 2350 patients ont été hospitalisés dans le service de médecine interne dont 390 diabétiques. Parmi eux, 138 patients ont répondu à nos critères d'inclusion soit une prévalence de 35,38%. La moyenne d'âge de nos malades était de 53,49 ans ± 15,65 ans avec un sex-ratio H/F était de 0,70 en faveur des femmes (81 femmes contre 57 hommes). Les infections responsables de la décompensation étaient à localisation cutanéo-muqueuse (30,4%), pulmonaire (22,4%), uro-génitale (18,11%), buccodentaire (10,11%), ORL (1,44%), phanérienne (0,72%). Ailleurs, une infection aux pieds était retrouvée chez 43 patients soit 31,15% des cas. Plusieurs infections pouvaient être présentes chez un même malade. Le diabète était déséquilibré dans 86,2 % (n=94) des cas avec une HbA1c moyenne à 10, 5 % à l'admission Nous n'avons pas noté de corrélation entre l'infection et l'ancienneté du diabète (p =0, 60), l'infection et le type de diabète (p = 0,50) et paradoxalement entre l'infection et le déséquilibre du diabète (p=0,70). Conclusion : Le dépistage des infections chez le diabétique en déséquilibre chronique ou diabétique de novo doit être systématique car généralement ces infections peuvent être asymptomatiques.
Introduction: Infections in people with diabetes have long been considered one of the causes of increased morbidity and mortality. They represent an increasingly frequent reason for admission to the Department of Internal Medicine of the Regional and University Hospital of Thies. The mechanisms are more or less elucidated by the influence of hyperglycemia on neutrophil polynuclear functions. The purpose of this study is to determine the epidemiological characteristics of infections in diabetics. Method: This was a retrospective study with data collected over 24 months (1 January 2016 to 31 December 2018) at the Internal Medicine Department of the Regional and University Hospital of Thies. This study included all diabetic patients, regardless of gender and type of diabetes, aged 15 years and older, with an infection as the primary decompensation factor. Result: During the study period 2,350 patients were hospitalized in the Internal Medicine Department, 390 of whom were diabetic. Of these, 138 patients met our inclusion criteria, a prevalence of 35.38%. The average age of our patients was 53.49 years 15.65 years with a sex-ratio H/F was 0.70 in favor of women (81 Women versus 57 Men). The infections responsible for decompensation were dermal localization (30.4%), pulmonary (22.4%), urogenital (18.11%), oral (10.11%), ENT (1.44%), phanerian (0.72%). Elsewhere, a foot infection was found in 43 patients or 31.15% of cases. Several infections could be present in the same patient. Diabetes was unbalanced in 86.2% (n=94) of cases with an average HbA1c of 10.5% at admission We did not find a correlation between the infection and the age of diabetes (p =0, 60), the infection and the type of diabetes (p = 0.50), and paradoxically between the infection and the imbalance of diabetes (p = 0.70). Conclusion: The detection of infections in diabetics in chronic imbalance or de novo diabetics must be systematic because generally these infections can be asymptomatic.
Subject(s)
Humans , Male , Female , Respiratory Tract Infections , Diabetes Complications , Diabetes Mellitus , Skin Diseases, Infectious , VaricoceleABSTRACT
The objectives of this study were to compare perinatal outcomes in twin pregnancies where the first twin was in the breech presentation. To do so, we performed a 10-year retrospective cohort study in a single university center. All patients with a twin pregnancy with the first twin in breech presentation, a gestational age greater than or equal to 34 weeks' gestation, and a birth weight >= 1500 g were included. The main outcome measures were 5-minute Apgar score <7 and perinatal mortality. We included 353 pairs of twins which complied with the inclusion criteria. One hundred and fifty (150) patients delivered vaginally while 203 pairs of twins were delivered by caesarean section. Patients who delivered abdominally were similar to those who delivered vaginally with regard to age, parity, and gestational age. Six twins A delivered vaginally and 2 delivered by caesarean section had an Apgar score < 7 (p = 0.76) whereas 12 twins B delivered vaginally and 2 delivered abdominally had an Apgar score <7 (p = 0.001). Perinatal mortality did not differ significantly between twins delivered abdominally and those delivered vaginally. There was no evidence that vaginal delivery was risky with regards to depressed Apgar scores for Twin A and neonatal mortality for breech first twins that weighed at least 1500 g. However, Twin B delivered vaginally were more likely to present with a low 5-minute Apgar score. Along with the literature, the findings of this study do not currently allow to define a consensual obstetric attitude towards management of breech first twin deliveries. Until more prospective multicenter randomized controlled studies shed light on this problem, the skills, experience and judgment of the obstetrician will play a major role in the decision-making process. (Afr J Reprod Health 2022; 26[5]: 50-56).
Subject(s)
Cesarean Section , Vaginal Birth after Cesarean , Pregnancy, Twin , Senegal , Pregnancy Outcome , Perinatal DeathABSTRACT
Introduction: le test Xpert MTB/RIF présente un double avantage d'une part le diagnostic rapide des cas mêmes difficiles par la technique standard de l'examen direct à la microscopie et d'autre part par la détection de la résistance à la rifampicine. Notre objectif était de déterminer l'apport du test Xpert dans le diagnostic de la tuberculose toutes formes confondues. Matériels et méthode : étude transversale, descriptive à collecte rétrospective menée dans le service de Pneumophtisiologie de CHRU de Saint-Louis. Tous les cas suspects de tuberculose qui avaient bénéficié d'un test Xpert de 2018 à 2020avec un dossier médical accessible et exploitable ont été inclus. Les paramètres étudiés étaient les données sociodémographiques, cliniques et biologiques. Résultats : Nous avions colligés 524dossiers de malades avec un sex-ratio de 1,3. L'âge moyen des patients était de 37 ans+/-15 ans. Il y'avait 285 prélèvements positifs au GeneXpert dont 224 d'origine pulmonaire et 61d'origine extra pulmonaire. Le nombre d'échantillons résistants à la rifampicine était de cinq, tous d'origine respiratoire. Conclusion: le test Xpert est une nouvelle technique moléculaire recommandée par l'OMS dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Toutefois il doit être évaluer dans le diagnostic de la tuberculose extra pulmonaire
Introduction: The Xpert MTB / RIF assay has a dual advantage on the one hand, the rapid diagnosis of even difficult cases by the standard technique of direct microscopic examination and on the other hand by the detection of resistance to rifampicin. Our objective was to determine the contribution of the Xpert test in the diagnosis of tuberculosis of all forms. Materials and method: retrospective, descriptive and analytical study carried out in the Pneumophtisiology department of the CHRU of Saint-Louis. All suspected tuberculosis cases who had received an Xpert test from 2018 to 2020 were included. The parameters studied were socio-demographic, clinical and biological data. Results: 524 patient records included in the study with a sex ratio of 1.3. The mean age of the patients was 37 +/-15 years. There were 285 positive GeneXpert samples, of which 224 were of pulmonary origin and 61 of extra-pulmonary origin. The number of rifampicin resistant samples was five, all of respiratory origin. Conclusion: the Xpert test is a new molecular technique recommended by the WHO in the diagnosis of pulmonary tuberculosis
Subject(s)
Tuberculosis , Diagnosis , Lung Diseases , SenegalABSTRACT
Introduction: La fulgurante progression de la pandémie à covid -19 a imposé au Sénégal l'adoption de stratégies de riposte parmi lesquelles la mise en place de centres de traitement des épidémies (CTE) au sein des hôpitaux . Nous nous proposons d'évaluer les activités d'un CTE Covid-19 implanté dans un service de médecine interne et les leçons tirées de ce vécu. Méthodologie : Le CTE Covid -19 a été installé dans le service de médecine interne de l'Hôpital Régional de Thiès (HRT), mais avec conservation de lits dédiés aux patients non atteints de Covid-19. Les étudiants en année de doctorat affectés dans le service de médecine interne étaient responsables de la gestion quotidienne du CTE sous la supervision des spécialistes en médecine interne Ce service était subdivisé en deux parties: le CTE qui prenait en charge les cas de Covid -19 et le reste du service qui devait continuer à accueillir les patients atteints d'autres affections ou qui y étaient régulièrement suivies. Résultats : Du 1er mai au 30 octobre 2020, 237 patients ont été admis dans le CTE. Ils étaient âgés de 7 à 88 ans avec une moyenne d'âge de 53,41 ans et un sexe ratio de 1,60. Les motifs d'admission étaient une désaturation en oxygène inférieure à 90%, la présence d'au moins une comorbidité (autres infections, diabète , hypertension artérielle , obésité, maladies auto-immunes, cancers ). L'âge avancé mais aussi les patients ne pouvant être à domicile faisaient également partie des critères d'admission . Trois (3) cas de co-infection Covid-19 et tuberculose pulmonaire ont été relevés et trois (3) patients avaient un portage chronique du virus de l'hépatite B. Dans le cadre des hospitalisations non Covid -19, les affections suivantes ont été retrouvées : 8 cas de diabète déséquilibrés et autant d'hépatopathie (6,10%); l'accès palustre dans 3, 05% (n=3) ; la tuberculose pulmonaire (3,81%, n=3) ; 3 cas (2,29 %) d'anémie de type biermerien et de lupus érythémateux systémique. De même, 1 cas (0,76%) d 'empyème cérébral ; une polyarthrite rhumatoïde (0,76 %), une (01) maladie rénale chronique , 1 cas de défaillance cardiaque ont également été enregistrées. Cinq (5) cas (3,81 %) non affectés par l'infection à Covid -19 , à leur admission l'ont été au cours de leur hospitalisation et donc transférés au niveau de la zone rouge du CTE. Conclusion: La mise en place du CTE au niveau du service de Médecine interne , a permis une adaptation efficiente dans la prise en charge des patients concernés mais aussi de ceux qui étaient suivis pour des pathologies chroniques comme les urgences médicales reçues durant la période. La continuité des soins a été assurée et les liens avec les autres secteurs de la pyramide sanitaire du Sénégal ont été raffermis.
Introduction : The fast progression of covid -19 throughout the world has forced Senegal to adopt response strategies including the establishment of Outbreak Center for Covid- 19 (OCC ) within hospitals . We propose to evaluate the activi ties of an OCC implemented in an internal medicine department and the lessons learned from this experience. Methodology: The center for care of Covid-19 has been installed in the Internal Medicine department of the Thies Regional Hospital (HRT ), but with dedicated beds for patients non affected by the pandemic . Fifteen doctoral students were assigned, by local medical school , to the Department of Internal Medicine in order to be responsible for the day-to-day management of the OCC. They were supervised by internal medicine specialists . This service was divided into two parts: the OCC that handled Covid -19 cases and the rest of the service , which was to continue to take care of patients with other conditions or who were regularly monitored. Results: From May 1 to October 30, 2020, 237 patients were admitted to the CTE They ranged from 7 to 88 years old with an average age of 53.41 and a sex ratio of 1.60 .The reasons for admission were an oxygen desaturation of less than 90%, the presence of at least one comorbidity (other infections, diabetes, arterial hypertension, obesity, autoimmune diseases, cancers, etc .). Advanced age but also patients who could not be at home were also part of the admission criteria. Three (3) cases of Covid -19 co -infection and pulmonary tuberculosis were identified and three (3) patients had a chronic carriage of the hepatitis B virus. In the context of non -Covid -19 hospitalizations, the following conditions have been found: 8 cases of unbalanced diabetes and as many hepatopathy (6.10%); malaria access in 3.05% (n = 3); pulmonary tuberculosis (3.81%, n = 3); 3 cases (2.29%) of biermeric type anemia and systemic lupus erythematosus. Similarly, 1 case (0.76 %) of cerebral empyema; rheumatoid arthritis (0.76%), one (01) chronic kidney disease, 1 case of heart failure were also recorded Five (5) cases (3.81%) not affected by Covid-19 infection, on admission, were during their hospitalization and therefore transferred to the red zone of the CTE. Conclusion : The establishment of the OCC in the internal medicine service allowed an efficient adaptation in the care of the patients affected by covid disease but also of those who were followed for chronic pathologies or admitted for other medical emergencies This strategy has improved and strengthened the links with other sectors of Senegal 's health pyramid.
Subject(s)
Humans , Male , Female , Tuberculosis, Pulmonary , Hepatitis B virus , Continuity of Patient Care , Coinfection , COVID-19 , Hospitalization , Lupus Erythematosus, SystemicABSTRACT
Objectifs :Évaluer l'apport de la TDM thoracique dans le diagnostic des patients suspects de COVID-19en comparaison avec la technique de référence (RT-PCR) et déterminer l'impact médico-économique de la COVID-19 au service de radiologie du CHU de Fann. Matériels et méthodes: Il s'agissait d'une étude rétrospective, descriptive sur une période de 4 mois allant du 1er avril au 31 Juillet 2020, au service de radiologie du CHU de Fann.Ont été inclus les patients reçus pour suspicion clinique de COVID-19, qui avaient eu une TDM thoracique et un prélèvement naso-pharyngé par écouvillonnage pour RT-PCR, soit au total 314 patients. Nous avons étudié les données épidémiologiques, cliniques, les images évocatrices de COVID-19 (opacités en verre dépoli, condensation, topographie lésionnelle), existence ou non d'une embolie, les anomalies en faveur de surinfection, les lésions associées, l'impact sur la fréquentation des différentes modalités etl'impact sur les recettes. Résultats:L'âge médian était de 62 ans et le sex-ratio 1,61. La fièvre a été présente chez 7 patients (2,23%); la toux chez 17 patients (5,41%); la dyspnée chez 30 patients (9,55%) et un syndrome de détresse respiratoire chez 63 patients (20,07%). La clinique n'a pas été précisée chez 163 patients (51,91%). La TDM thoracique était normale chez 20 patients (6,37%), évocatrice de COVID-19 chez 274 patients (87,26%) et non évocatrice de COVID-19 chez 20 patients (6,37%). La RT-PCR était positive chez 125 patients soit 39,80%. La sensibilité et la spécificité de la TDM étaient respectivement de 91,2% et 15,34%. La valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative et le taux de précision étaient respectivement de 42%, 72,5% et 45,5%. La baisse du taux de fréquentation était de 59% en radiographie standard, 55% en échographie, 24% au scanner et 87% en mammographie. Dans notre étude on a noté une baisse de 40% des recettes au second trimestre de 2020 comparativement au premier trimestre. Conclusion: La TDM thoracique a une bonne sensibilité pour le diagnostic de la COVID-19. De ce fait, elle peut être considérée comme un outil principal pour la détection des lésions pulmonaires évocatrices de pneumonie COVID-19. Les impacts médico-économiques de la COVID-19 ont été considérables.
Subject(s)
Humans , Male , Female , Mass Chest X-Ray , Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction , COVID-19 , Senegal , EconomicsABSTRACT
Introduction: La coronarographie est une méthode exploratrice et thérapeutique des artères coronaires qui connait depuis quelques années des avancées remarquables, de telle sorte que ses indications peuvent s'étendre à tous les âges en fonction des orientations cliniques. L'objectif de ce travail était de décrire les aspects des artères coronaires chez les patients de moins de 40 ans explorés au CHU Aristide Le Dantec.Patients et Méthodes: Nous avons effectué une étude descriptive qui incluait tous les patients dont l'âge était inférieur ou égal à 40 ans et qui avaient eu une coronarographie suite à un consentement éclairé dans la période du 1er Mai 2014 au 31 Août 2017. Les paramètres étudiés étaient épidémiologiques, cliniques, coronarographique, incluant l'éventuelle angioplastie Résultats: Nous avions inclus 32 patients. L'âge moyen était de 33,84 ± 5,59 ans, avec un minimum de 18 ans. Le genre masculin prédominait avec 27 hommes. Le facteur de risque cardio-vasculaire le plus fréquemment retrouvé était le tabac (28,13%) suivi de la dyslipidémie (25%), de l'hérédité (18,75%) et du surpoids (15,6%). Chez deux patients (6,25%), on a noté une consommation de substance stupéfiante. Les indications de la coronarographie étaient entre autres, le syndrome coronaire aigu (72%) et l'angor d'effort à (19%). La coronarographie était normale chez 11 patients et Pathologique chez les 21 restants, incluant 15 cas (46,87%) avec des lésions serrées. Les atteintes angiographiquement significatives étaient dominées par les atteintes mono-tronculaires dans 50% des cas. L'angioplastie était réalisée avec satisfaction chez 5 patients avec une prédominance de stents nus.Conclusion : Chez le sujet jeune avec syndrome coronarien aigu ou angor d'effort, le facteur de risque le plus fréquent est le tabac et l'atteinte coronaire est le plus souvent mono tronculaire
Subject(s)
Coronary Angiography , Coronary Artery Disease , SenegalABSTRACT
Une lésion du ligament croisé antérieur (LCA) est un événement multifactoriel influencé par des facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques. Si les facteurs extrinsèques peuvent être modifiés, il n'en est pas de même pour les facteurs intrinsèques. Récemment, la géométrie du tibia proximal est considérée comme un facteur de risque possible pour une lésion du LCA.Hypothèse : Une pente tibiale élevée est associée à un risque élevé d'une lésion du LCA.Matériel et méthode : Nous avons comparé deux groupes : le premier de 32 patients avec rupture du LCA et le second de 32 patients sans lésion du LCA. Tous les patients ont bénéficié d'une radiographie du genou de profil. Ces radiographies de profil ont permis de calculer la pente tibiale selon trois méthodes en fonction de l'axe tibial choisi (corticale antérieure, tibial proximal de Dejour et Bonnin, corticale postérieure). Les valeurs des pentes tibiales ont été saisies sur Excel et analysées avec le logiciel Stata version 15.Résultats : Les moyennes de la pente tibiale mesurée dans le groupe 1 étaient de 16,40Ë selon la corticale antérieure ; 12,54Ë selon l'axe anatomique de Dejour et Bonnin et 8,92Ë selon la corticale postérieure. Les moyennes dans le groupe 2 étaient de 13,37Ë selon la corticale antérieure ; 9,80Ë selon l'axe anatomique de Dejour et Bonnin et 6,96Ë selon la corticale postérieure. L'analyse comparative entre les pentes tibiales du groupe 2 et celles du groupe 1, montre une majoration de la pente tibiale statistiquement significative pour les trois pentes tibiales.Conclusion : Il apparaît, à travers ces résultats, que la valeur de la pente tibiale est corrélée à la rupture du LCA. C'est une donnée fondamentale à prendre en considération lors des plasties ligamentaires, mais aussi dans toute chirurgie du genou
Subject(s)
Anterior Cruciate Ligament , Knee , Radiologic Health , Rupture , SenegalABSTRACT
Introduction. Nous décrivons un cas d'agénésies dentaire multiples associées à une ectopie bilatérale des troisièmes molaires ainsi de la deuxième prémolaire mandibulaire gauche. Cas clinique: Une patiente de 30ans était référée par son médecin gastroentérologue pour une prise en charge odontologique. La patiente décrit de ne jamais avoir bénéficié d'avulsion dentaire et ne souffrait d'aucun douleur ou gène au niveau orofacial. Une exploration clinique suivie d'examens radiologiques était réalisé. L'examen clinique révèle l'absence de plusieurs dents. La radiographie panoramique avait permis de confirmer le diagnostic d'agénésies multiples de huit dents. Les deux troisièmes molaires mandibulaires incluses en position verticale au niveau de la branche mandibulaire. La 35 aussi incluse en position apicale de la 38. L'examen CBCT montre une déhiscence des corticales des faces interne et externe du ramus en regarde des couronnes des troisièmes molaires. Discussion. L'oligodontie associée à une inclusion dentaire multiple reste un cas rare. Les éléments de l'examen clinique associés à la radiographie panoramique permettent de confirmer le diagnostic d'agénésie et d'ectopie dentaires. La radiologie tri dimensionnelle est capitale dans la prise de décision thérapeutique des dents ectopiques en position condy lienne.Conclusion. Sans symptomatologie clinique et radiologique, la décision thérapeutique était de s'abstenir de traitement chirurgical et de surveiller
Subject(s)
Cone-Beam Computed Tomography , Radiography, Panoramic , Senegal , Tooth, UneruptedABSTRACT
Introduction:L'hyperprolactinémie, qui est une sécrétion supra physiologique de prolactine est en clinique le désordre hypophysaire antérieur le plus fréquemment rencontré. Son incidence et sa prévalence sont peu définies, en Afrique et dans le reste du Monde.Les objectifs étaient d'étudier les aspects cliniques, paracliniques, étiologiques et thérapeutiques de l'hyperprolactinémie à l'hôpital du Mali.Méthodologie :Il s'agissait d'une étude transversale de 5 ans. La collecte des données a été rétrospective (juillet 2011 à octobre 2015) et prospective (décembre 2015 à juillet 2016).Résultats:Nous avons colligés 37 cas d'hyperprolactinémie. Le sex ratio était de 0,85. L'âge moyen était 37,32ans avec des extrêmes allant de 15 à 74 ans. Le tableau clinique était dominé chez les femmes par l'aménorrhée (80%), la galactorrhée (70%), les céphalées (55%), l'hypofertilité (50%), les troubles visuels (25%) et chez les hommes par la baisse de la libido (64,7%), la gynécomastie (47,1%), lescéphalées (47,1%), les troubles visuels (41,2%) et les troubles de l'érection (29,4%). La prolactinémie basale était supérieure à 100ng/mlchez 45,9% des patients. La tomodensitométrie cérébrale avait objectivé : 11 cas de macroadénomes et 5 cas demicroadénomes hypophysaires. Les principals causes de l'hyperprolactinémie étaient : l'adénome hypophysaire à prolactine (43,24%) ;l'hypothyroïdie(5,40%) et la prise d'oestroprogestatifs chez 5,40%. Pour le traitement, 64,9% des patients étaient mis sous cabergoline ; 27% sous bromocriptine et8,10% sous simple surveillance clinique et biologique.Conclusion:L'hyperprolactinémie est une pathologie qui existe dans nos structures de santé. Les cliniciens doivent y penser devant une aménorrhée galactorrhée ou une baisse de la libido. Il est aussi nécessaire d'améliorer le plateau technique pour une meilleure prise en charge
Subject(s)
Diagnosis , HyperprolactinemiaABSTRACT
Introduction: aural foreign bodies (FB) are frequent in pediatric otorhinolaryngology and in pediatric emergencies. The objective of this study was to describe the socio-demographic, clinical and therapeutic aspects of aural FB in children in a pediatric hospital in Senegal. Methods: this was a four-year hospital-based descriptive study performed in the Otorhinolaryngology department of the Children's Hospital of Diamniadio, from 1st January 2013 to 31 December 2016 including all children under 15 years of age received for aural FB. The variables studied were age, gender, provenance, presenting symptom, time to consultation, the type of FB and morbidity. Results: sixty three FB were extracted. Mean age was 6 years 4 months. 52.4% of patients were under 5 years old. There was a slight female predominance (32/63). Location was in the right ear canal in 55.6%. Seventy three percent of patients presented in our office were asymptomatic. The median time to consultation was 4 days. Within the first 24 hours after insertion, 22.2% of children presented to our office. Beads were the first FB (29.68%), followed by seeds and cotton (12.5% respectively). Foreign bodies' extraction were performed in consultation for 79.4% of patients. The morbidity was 20.6%. It was primarily otitis externa (8%). Myringoplasty was performed in one patient who had sequelae of tympanic membrane perforation. Conclusion: aural FB is a common accident in under-5 year-olds. In our context there is a delayed consultation. Morbidity is similar to that of the literature
Subject(s)
Child , Ear Canal , Foreign Bodies , Hospitals, Pediatric , Otolaryngology , SenegalABSTRACT
Introduction: to investigate the clinical characteristics of COVID-19 in pregnancy in Senegal. Methods: this was a cross-sectional and descriptive study of all cases of COVID-19 including nine pregnant women who were admitted in COVID-19 treatment centers in Senegal from March 2 to May 15, 2020. SARS-COV-2 infection was confirmed by PCR. Patients' characteristics, clinical features, treatment and outcome were obtained with a customized data collection form. Results: the frequency of the association COVID-19 and pregnancy was 0.5%. The age range of the patients was 18-42 years with an average 28 years, and the range of gestational weeks at admission was 7 weeks to 32 weeks. None of the patients had underlying diseases. All the patients presented with a headache and only four of them had fever. Other symptoms were also observed: two patients had a cough, two had rhinorrhea, and two patients reported poor appetite. The median time to recovery was 13.6 days, corresponding to the number of days in hospital. None of the nine pregnant women developed severe COVID-19 pneumonia or died. Conclusion: pregnant women appear to have the same contamination predispositions and clinical features of SARS-COV-2 infection as the general population. This study shows no evidence that pregnant women are more susceptible to infection with coronavirus
Subject(s)
COVID-19 , Pregnant Women , SenegalABSTRACT
Introduction : La syndactylie congénitale est une fusion plus ou moins complète des doigts de la main et/ou des orteils. C'est la plus fréquente des anomalies congénitales de la main. Le but de cette étude était d'analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques des syndactylies congénitales de la main dans une structure spécialisée en chirurgie de la main. Patients et méthodes: Cette étude était rétrospective, monocentrique,et descriptive. Elle a concerné des enfants âgés de moins de 15ans hospitalisés entre janvier 2002 et décembre 2017 dans le service de chirurgie plastique et reconstructrice du CHU Aristide le Dantec de Dakar pour une syndactylie congénitale de la main. Les données recueillies étaient épidémiologiques cliniques, thérapeutiques, et évolutives. Résultats : Il s'agissait de 61 patients (113 commissures). Il y avait 44 garçons et 17 filles. L'âge moyen à l'intervention était de 6 mois (3mois-7ans). La notion de consanguinité était rapportée chez 39 patients (64%) et chez 14% (n = 6) d'entre eux, il existait un antécédent de syndactylie familiale. Aucun diagnostic anténatal n'a été posé La malformation était bilatérale chez 22 patients (36 %). La syndactylie était simple complète (n=29; 47,5%), simple incomplète (n=19 ;31%) et complexe (n=13 ;21,5%). Les commissures concernées étaient la 1ère (n=4 ; 3,5%), la 2ème (n=20 ; 17,5%), la 3ème (n=56 ; 49,5%) et la 4ème (n=33 ; 29,5%). Une malformation associée était objectivée chez 21 (34 ,5%) patients dont 14 syndactylies du pied. Quarante-huit (78%) patients (68 commissures) ont eu un geste chirurgical dans un délai inférieur à 1 an pour 94,64% (n=45). L'incision en zig-zag était la seule technique pratiquée pour la séparation digitale. La séparation commissurale était faite selon une plastie en VY (n=28 ; 58,5%), en V croisé (n=15, 31%), et en rectangle (n=5 ; 10,5%). La réparation utilisait une greffe de peau totale inguinale (n=36, 75%), une greffe associée à une plastie (n=6, 12,5%) et une plastie (n=6, 12,5%). Des complications ont été notées chez 15 (31%) patients. Il s'agissait de six récidives partielles, six nécroses de greffe dont deux en rapport avec une infection et trois cicatrices chéloïdiennes. Quarante (83 %) patients avaient un résultat satisfaisant avec un recul moyen de 12 mois (3 - 48). Conclusion : Les syndactylies simples et complètes étaient les plus fréquentes. Les 3ème et 4ème commissures étaient les plus intéressées. La réparation par plastie en VY associée à une greffe de peau totale était couramment réalisée. Les résultats étaient satisfaisants. Le suivi à long terme est compromis. Il est lié aux difficultés socio-économiques des patients
Subject(s)
Child , Hand , Patients , Senegal , Syndactyly , Syndactyly/epidemiologyABSTRACT
Introduction : l'hépatite aiguë est fréquente et représente un problème de santé publique dans les pays en développement. Les étiologies sont dominées par l'hépatite A en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Cependant, très peu d'études locales ont porté sur cette pathologie. Objectif : Étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs des hépatites aiguës chez les enfants hospitalisés au CHNEAR. Matériel et Méthodes : il s'agissait d'une étude rétrospective réalisée au CHNEAR de Dakar du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017. Étaient inclus les enfants hospitalisés pour une hépatite aiguë. Les données socio démographiques, cliniques, paracliniques et évolutives ont été recueillies. L'analyse des données uni et bivariée était faite grâce au logiciel R studio version 3.5.0. Résultats : au total, 35 000 enfants étaient hospitalisés durant la période d'étude parmi lesquels 71 patients avaient une hépatite aiguë déterminant une prévalence hospitalière de 0,2%. L'âge moyen à l'admission était de 65 mois avec un sex-ratio de 1,5. L'ictère cutanéo-muqueux était le principal signe physique (81,7%). La cytolyse était constante avec une moyenne des ALAT de 549UI/L. Une insuffisance hépatocellulaire était notée chez 24% des patients. L'étiologie était dans la grande majorité des cas indéterminée (66,2%). L'hépatite A représentait 15,5% et la phytothérapie (18,3%). L'évolution était favorable dans l'ensemble sans aucun cas de rechute. La létalité était de 16,9%. Conclusion : l'étiologie des hépatites demeurent encore indéterminées dans une large proportion au CHNEAR de Dakar. Le pronostic reste réservé pour les formes graves avec insuffisance hépatocellulaire
Subject(s)
Academic Medical Centers , Child , Disease Progression , Hepatitis A/diagnosis , Hepatitis A/epidemiology , Hepatitis A/etiology , Hepatitis, Viral, Human , SenegalABSTRACT
Introduction:La thrombose veineuse cérébrale représente une pathologie vasculaire veineuse autrefois dite rare. Objectif:L'objectif principal de notre étude était d'étudier les différents aspects cliniques, paracliniques, étiologiques et évolutifs des thromboses veineuses cérébrales. Méthodologie:Il s'agissait d'une étude prospective de 30 cas de thromboses veineuses cérébrales admis au service deneurologie de Fann durant la période allant de janvier 2013 à juillet 2016. L'imagerie cérébrale était le critèreindispensable pour confirmer le diagnostic.Résultats:Notre enquête comportait 21 femmes et 9 hommes avec un âge moyen de 34,4 ans. L'installation des signes était subaigüe dans la majorité des cas. Le motif d'admission était polymorphe, dominé par les céphalées(86,7%), les vomissements (60,0%), l'hémiplégie (56,7%). L'imagerie cérébrale révélait majoritairement 14 cas de thrombose du sinus latéral (46,7 %) et 10 cas de sinus longitudinal supérieur (33,3%). Les causes non infectieuses (50%) notamment gynéco-obstétricales dominaient. L'évolution sous héparinothérapie était le plus souvent favorable ; seules des céphalées séquellaires demeuraient. Conclusion La thrombophlébite cérébrale constitue une urgence pronostique et thérapeutique. La variabilité du diagnostic pourrait expliquer le retard de la prise en charge
Subject(s)
Academic Medical Centers , Disease Progression , Senegal , Venous Thrombosis/diagnosis , Venous Thrombosis/etiologyABSTRACT
Description: L'épilepsie-absence est un syndrome épileptique généralisé, fréquent, de cause présumée génétique, caractérisé par la survenue d'épisodes fréquents de rupture brutale et complète du contact sans perte de tonus. Objectif: L'objectif était de décrire l'épidémiologie et les caractéristiques cliniques de l'épilepsie-absence chez l'enfant et l'adolescent. Méthode: Nous avons mené une étude transversale longitudinale, portant sur 53 patients, de décembre 2003 à mars 2014 en colligeant les données épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutives. L'analyse des données s'est faite avec le logiciel statistique CSPro 5.0 avec calcul de fréquences et moyennes. Résultats: Cinquante trois patients dont 42 enfants et 11 adolescents ont été colligé avec un âge moyen de 10 ans. L'âge moyen de début des crises était de 6,8 ans chez les enfants et 12,4 ans chez les adolescents. On notait une prédominance féminine à 52,4 % chez les enfants et masculine à 63,6 % chez les adolescents. Une consanguinité parentale était retrouvée dans 55,5 % chez l'enfant et 37,5 % chez l'adolescent. Quarante pourcent des enfants présentaient des antécédents familiaux d'épilepsie. Les crises survenaient spontanément dans 86,8 % des cas avec une durée moyenne de 10 secondes environ. Le Valproate de sodium a été utilisé chez tous nos patients avec une maitrise dans 81,6 % à trois mois. L'évolution de l'épilepsie-absence était globalement satisfaisante avec des difficultés d'apprentissage observées chez 22,6 % des patients. Conclusion: L'épilepsie-absence est fréquente, de causes multifactorielles et peut retentir sur le devenir psychosocial
Subject(s)
Adolescent , Child , Epilepsy/diagnosis , Epilepsy/epidemiology , Epilepsy/therapy , Prognosis , SenegalABSTRACT
L'ostéonécrose maxillo-mandibulaire induite par les bisphosphonates (ONBP) est un effet indésirable décrit pour la 1 ère fois en 2003. La gestion de cette pathologie reste difficile compte tenu de la gravité de cette pathologie et la complexité de ses lésions. A travers une étude marocaine sur 36 cas, les auteurs soulignent l'intérêt des mesures préventives et l'importance d'études prospectives avec un échantillonnage significatif, afin de mieux préciser les facteurs de risque associés à la survenue d'une ONBP et de déterminer les catégories des patients à risque nécessitant une adaptation de la prise en charge
Subject(s)
Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw/diagnosis , Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw/prevention & control , Case Reports , Disease Management , MoroccoABSTRACT
Objectifs : Décrire les aspects diagnostiques, thérapeutiques des cancers colorectaux en occlusion et évaluer les différentes modalités thérapeutiques chirurgicales. Patients et Méthodes : Il s'agissaitd'une étude rétrospective, descriptive et analytique effectuée dans le service de chirurgie viscérale de l'Hôpital Principal de Dakar, de janvier 2008 à décembre 2014, incluant 37 patients pris en charge pour cancer colique ou rectal en occlusion. Les paramètres étudiés étaient l'âge, le genre, l'unité de provenance, les antécédents, les données de l'examen clinique et paraclinique, le traitement et l'évolution. Les données saisies sur Excel, étaient analysées avec le logiciel SPSS. Des comparaisonsintergroupes étaient effectuées grâce aux tests de Pearson ou de Fisher pour les valeurs qualitatives,de Student ou ANNOVA pour les valeurs quantitatives, avec un seuil de significativité de 5% en situation bilatérale. Résultats : Les dossiers cliniques de 22 hommes et 15 femmes étaient colligés.L'âge moyen des patients était de 61,2 ans. Le diagnostic d'occlusion tumorale était tomodensitométrique dans 23 cas et dans 14 cas per opératoire. Quatre tumeurs siégeaient au côlon droit, 28 au côlon gauche et 5 au rectum. Pour les tumeurs du rectum, étaient réalisées 5 colostomies de décharge en urgence sans résection tumorale secondaire. Pour les tumeurs coliques droites, un patient avait bénéficié d'une caecostomie en urgence suivie d'une hémicolectomie droite et 3 patients d'une chirurgie palliative en urgence (dérivation interne, caecostomie, iléostomie dans 1 cas respectivement). Pour le siège colique gauche, une résection tumorale en urgence était réalisée dans 8cas (5 colectomies gauches idéales, 2 Hartmann, 1 Bouilly Wolkman). Dix sept patients avaient bénéficié d'une colostomie de décharge en urgence suivie d'une résection tumorale secondaire chez 12 d'entre eux. Trois patients avaient bénéficié d'une dérivation interne. L'histologie obtenue dans 27 cas,était en faveur d'un adénocarcinome dans 26 cas. Neuf patients avaient bénéficié La morbidité et la mortalité globale était respectivement de 35% et 13,5%.d'une chimiotheraphie Pourleslocalisations coliques gauches, cette morbi-mortalité en cas de stratégie en 2 temps était respectivement de 17,6% et 11,7%. En cas de colectomie idéale en urgence, elle était respectivement de 40% et 20%.La survie globale à 1 an était de 43,2%. Conclusion : Nos résultats confirment la gravité du cancer colorectal en occlusion et plaident pour la colostomie première suivie de la résection tumorale secondaire pour les tumeurs au côlon gauche
Subject(s)
Colorectal Neoplasms , Colostomy , Dental Occlusion , SenegalABSTRACT
Objectifs : Notre objectif était d'évaluer les facteurs étiologiques, les agents pathogènes, le traitement et les séquelles des périchondrites. Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective, sur une période de 8 ans (janvier 2009 à décembre 2016), portant sur les cas de périchondrite aiguë au service d'ORL du CHNU de Fann. Résultats : Vingt-deux dossiers ont été colligés avec un cas de périchondrite bilatérale. Le sex-ratio était de 0.37 ; l'âge moyen de 27 ans. La durée d'évolution moyenne était de 23 jours. La circonstance de survenue était un piercing dans 36% des cas. Dix-neuf de nos patients présentaient une périchondrite collectée, soit 86% des cas. Quinze de nos patients avaient bénéficié d'un examen bactériologique de pus, soit 68% des cas. Le Pseudomonas aeruginosa était retrouvé dans 66.6% des cas, sensible dans 90% des cas à la ciprofloxacine et dans 10% des cas aux aminosides. La culture était négative dans 26.6% des cas. La durée moyenne d'hospitalisation était de 7 jours ; la durée moyenne du traitement de 13 jours. L'évolution était satisfaisante chez tous nos patients, avec une absence de séquelles dans 72.7% des cas. Conclusion : La périchondrite aiguë du pavillon de l'oreille se développe souvent suite à un traumatisme externe mineur. Le Pseudomonas aeruginosa représente le principal agent causal d'où l'intérêt d'une antibiothérapie probabiliste active sur ce dernier. Un traitement précoce permet de prévenir les séquelles morphologiques inesthétiques
Subject(s)
Laryngeal Diseases , Patients , Pseudomonas aeruginosa , SenegalABSTRACT
Introduction : Le schwannome est une tumeur bénigne développée aux dépens des cellules de Schwann des nerfs périphériques. La localisation endonasale en particulier au niveau des cornets est rare. Observation : Nous rapportons le cas d'une femme de 23 ans reçue dans notre structure pour une masse de la fosse nasale droite localisée au niveau du cornet inférieur, obstruant totalement la lumière nasale, sans envahissement local. Après un bilan endoscopique et radiologique, l'exérèse a été effectuée par voie endoscopique endonasale. L'analyse de la pièce opératoire avait mis en évidence un schwannome. Avec un recul de 24 mois nous n'avons pas noté de récidive. Conclusion : Le schwannome à point de départ turbinal inférieur constitue une entité rare. Il doit être considéré dans le diagnostic différentiel d'une tumeur bénigne unilatérale des cavités naso-sinusiennes