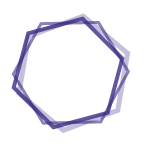ABSTRACT
Background: Data about injury patterns and clinical outcomes are essential to address the burden of injury in low- and middle-income countries. Institutional trauma registries (ITRs) are a key tool for collecting epidemiologic data about injury. This study uses ITR data to describe the demographics and patterns of injury of trauma patients in Addis Ababa, Ethiopia in order to identify opportunities for injury prevention, systems strengthening and further research. Methods: This is an analysis of prospectively collected data from a sustainable ITR at Menelik II Specialized Hospital, a public teaching hospital with trauma expertise. All patients presenting to the hospital with serious injuries requiring intervention or admission over a 13 month period were included. Univariable and bivariable analyses were performed for patient demographics and injury characteristics. Results: A total of 854 patients with serious injuries were treated during the study period. Median age was 33 years and 74% were male. The most common mechanisms of injury were road traffic injuries (RTI) (37%), falls (30%) and blunt assault (17%). Over half of RTI victims were pedestrians. Median delay in presentation was 2 h; 17% of patients presented over 6 h after injury. 58% of patients were referred from another hospital or a clinic, and referrals accounted for 84% of patients arriving by ambulance. Median emergency center length of stay was 2 h and 62% of patients were discharged from the emergency center. Conclusion: This study highlights the utility of institutional trauma registries in collecting crucial injury surveillance data. In Addis Ababa, road safety is an important target for injury prevention. Our findings suggest that the most severely injured patients may not be making it to the referral centers with the capacity to treat their injuries, thus efforts to improve prehospital care and triage are needed. African relevance: Injury is a public health priority in Africa. Institutional trauma registries play a crucial role in efforts to improve trauma care by describing injury epidemiology to identify targets for injury prevention and systems strengthening efforts. In our context, pedestrian safety is a key target for injury prevention. Improving prehospital care and developing referral networks are goals for systems strengthening
Subject(s)
Ethiopia , Patients , Trauma, Nervous System , Wounds and Injuries , Wounds and Injuries/epidemiology , Wounds and Injuries/prevention & controlABSTRACT
Introduction: Injury is a leading cause of morbidity and mortality globally and disproportionately affects low-income countries. While most injury data comes from tertiary care centers in urban settings, the purpose of this study was to describe the characteristics and severity of injury in rural Uganda and the associated treatment patterns and delays in care. Methods: This is a retrospective cohort study of a trauma registry that was implemented at Masindi-Kitara Medical Center (MKMC), a rural hospital in Western Uganda. Demographic information, injury characteristics, modified Kampala Trauma Scores (M-KTS), and treatment modalities over a 12 month period were retrospectively collected from paper-based registry forms completed for all injury patients presenting to MKMC. Results: A total of 350 patients were entered into the trauma registry. Most patients were male (71.2%) with a median age of 26.5 years. Motorcycle crashes were the most prevalent mechanism of injury (42.3%) with the majority being unhelmeted (83.3%). Soft tissue injury was the most common diagnosis (44.9%). Patients were frequently treated in the outpatient department and then discharged (54.8%). Patients requiring admission or transfer (M-KTS = 11.57 or 11.67) tended to have a lower M-KTS than discharged patients (M-KTS = 12.75). Analgesics (74.6%) and antibiotics (52.9%) were the most common treatments administered. For those patients requiring admission (29.4%), only one in-hospital death was documented. Thirty-nine percent of patients reported a delay in seeking care, most frequently due to lack of transportation (31.5%) with a median time of delay of 11 h. Conclusion: Road traffic injuries were the leading cause of injury in Masindi, with a high proportion of injuries associated with unhelmeted motorcycle crashes. Future opportunities to prevent injury and improve care may be seen through improved prehospital care, enforcement of helmet laws, increased access to neurosurgical services, and enactment of hospital quality improvement measures
Subject(s)
Accidents, Traffic , Commission on Professional and Hospital Activities , Global Health , Uganda , Wounds and Injuries , Wounds and Injuries/epidemiologyABSTRACT
In late December 2019, there was an outbreak of a new Coronavirus infection in Wuhan, Hubei Province, China, which caused acute respiratory syndrome of unknown aetiology. The World Health Organization (WHO) named the virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2) or COVID-19 and declared the infection a pandemic on the 11th of March 2020. The first case of COVID-19 in Nigeria was reported on the 27th of February 2020 and since then the numbers of confirmed cases has been on the increase, at least in Nigeria. With no vaccine or cure in sight, only public health measures that include personal protective measures, physical distancing, environmental and travel-related measures have been recommended to mitigate and contain the spread of the disease. There is need to make testing for COVID-19 widely available so that the true burden of the infection will be described. This step should assist policy makers in making evidence-based decisions in the prevention and control of the disease
Subject(s)
Coronavirus Infections/epidemiology , Coronavirus Infections/transmission , NigeriaABSTRACT
Introduction: les algies pelviennes aiguës sont responsables d'une morbi-mortalité importante. L'objectif de ce travail était de décrire leurs aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques à Yaoundé.Méthodes: nous avons mené une étude transversale descriptive avec collecte prospective des données au Service de Gynécologie-Obstétrique de l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé du 1er avril au 31 juillet 2015. Nous avons inclus toutes les femmes admises pour douleur pelvienne dont l'évolution était inférieure à un mois et ayant accepté de participer à l'étude. Nous avons exclu les femmes qui étaient au troisième trimestre de grossesse ou en post-partum. Le logiciel Epi info version 3.5.4 a servi à l'analyse des données. Ces données ont été présentées sous forme de fréquence et de pourcentage.Résultats: au total 5915 femmes ont consulté pendant la période de l'étude dont 125(2,11%) étaient des algies pelviennes aiguës. La moyenne d'âge était de 29,5 ± 6,9 ans. Les étiologies des douleurs étaient les infections génitales hautes (36,8%) et la grossesse extra-utérine (18,4%). Le traitement surtout médical (92,8%), associait antibiotiques (65,5%), anti-inflammatoires (56,9%) et antalgiques (39,7%). La chirurgie a été réalisée chez 25(20%) patientes par laparotomie (80%) et cÅlioscopie (20%)L'indication chirurgicale était la grossesse extra-utérine dans 76% des cas. La régression de la douleur était obtenue chez 99% des cas. Conclusion: les d'algies pelviennes aigues survenaient chez les femmes jeunes, dues aux infections génitales hautes et à la grossesse extra-utérine étaient principalement. En cas de grossesse extra-utérine le traitement chirurgical était surtout la laparotomie
Subject(s)
Cameroon , Obstetrics and Gynecology Department, Hospital , Pelvic Pain/diagnosis , Pelvic Pain/epidemiology , Pelvic Pain/etiology , Pelvic Pain/therapy , WomenABSTRACT
Introduction : l'accident vasculaire cérébral (AVC) constitue un problème majeur de santé publique, tant par le nombre de personnes atteintes, que par ses conséquences médicales, sociales et économiques. L'objectif était de dégager les facteurs de mauvais pronostic vital à la phase aiguë de l'AVC artériel. Méthodes: il s'agit d'une étude prospective durant 4 mois portant sur les patients présentant une symptomatologie évocatrice d'AVC aux deux CHU de Sfax, Tunisie. Le suivi a été de 1 mois. Résultats: nous avons colligé 200 patients. Après un mois de suivi, la mortalité était de 19,9%. Les facteurs de mauvais pronostic vital étaient: le sexe masculin, la consommation de tabac, l'antécédent d'AVC, le score de Glasgow bas, le NIHSS élevé, les céphalées, les crises épileptiques symptomatiques aigues, le signe de Babinski, la mydriase, l'aphasie, la déviation conjuguée de la tête et des yeux, les chiffres élevés de pression artérielle systolique (PAS), pression artérielle diastolique (PAD) et pression artérielle pulmonaire (PAP), l'hyperthermie, l'hyperglycémie, l'hyperleucocytose, l'augmentation des CRP, créatinine, urée et la troponine Tc, la nature hémorragique de l'AVC, l'Ådème péri lésionnel, l'effet de masse, l'engagement, la topographie sylvienne totale de l'ischémie, la présence de signes précoces d'ischémie, l'hémorragie méningée, l'inondation ventriculaire, l'hydrocéphalie, le recours à une assistance respiratoire, au traitement anti-Ådémateux et antihypertenseur, la transformation hémorragique, l'épilepsie vasculaire, les complications infectieuses, métaboliques et de décubitus. Conclusion: l'identification des facteurs prédictifs du devenir vital permet d'optimiser les procédures thérapeutiques et mieux organiser les filières de prise en charge. Une étude comparative sera envisagée afin de mesurer l'impact des mesures correctives
Subject(s)
Prognosis , Stroke/diagnosis , Stroke/epidemiology , TunisiaABSTRACT
Context and objective. Ocular trauma is very common and its etiological factors vary by region and age group. This study aims to describe the magnitude and determinants of ocular trauma complications in rural areas. Methods. We conducted a retrospective study of patients admitted for ocular trauma at Kimpese Hospital between January 2014 and December 2016. Univariate logistic regression was used to assess the determinants of ocular trauma complications. The statistical significance level is pË 0.05. Results. A total of 223 patients were included. The majority of participants were men (69.5%), over 18 years of age (70%), with poor visual acuity (57.8%) and bilateral ocular involvement (51.1%). Plant objects (44.8%) and metal objects (15.2%) were the most common traumatic agents. After treatment, an improvement in visual acuity was observed in 64.3% of patients with previously poor visual acuity (p < 0.001). The delay of care > 7 days [aOR: 2.286 (95% CI: 1.302-4.012), p=0.004] and the poor visual acuity on admission [aOR: 5.906 (95% CI: 3.231-10.796), p< 0.0001] emerged as determinants of the onset of complications. Conclusion. Awareness-raising efforts for early consultation after ocular trauma and integration of eye care at the primary level should be promoted for efficiency in care
Subject(s)
Democratic Republic of the Congo , Eye Injuries/complications , Eye Injuries/epidemiology , Eye Injuries/etiology , Rural PopulationABSTRACT
Contexte et objectif. L'ampleur réelle des néphropathies congénitales est peu connue en Afrique et notamment en Guinée. L'objectif de cette étude était de déterminer la fréquence des néphropathies congénitales rencontrées. Méthodes. Cette étude documentaire de type descriptif sur la néphropathie congénitale, a été conduite entre les 1er janvier 2007 et 30 juin 2012, dans les services de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique de Donka. Les paramètres d'intêret englobaient les données épidémiologiques, cliniques et paracliniques. Résultats. Parmi les 34.448 dossiers colligés, 26 présentaient une néphropathie congénitale. Il s'agissait des néphroblastomes (n=17), des syndromes de jonction pyélo-urétérale (n=6), d'une hydronéphrose sur rein multikystique gauche (n=1), d'un rein multikystique en ptose (n=1) et d'une ectopie rénale (n=1). Le sexe masculin était prépondérant (21/26) avec un sexe ratio de 4,2/1. Les enfants de 29 jours à 2 ans étaient les plus touchés. Conclusion. Les néphropathies congénitales sont paraissent moins fréquentes dans cette institution hospitalière, à cause du manque d'un plateau technique diagnostique optimal. Le diagnostic précoce des néphropathies congénitales devrait être fait dans la période prénatale ce qui permettrait une meilleure prise en charge des enfants affectés
Subject(s)
Academic Medical Centers , Guinea , Kidney Diseases/diagnosis , Kidney Diseases/epidemiology , Multicystic Dysplastic Kidney , Wilms TumorABSTRACT
Introduction: Le virus de la varicelle et du zonaest à l'origine d'un large spectre d'atteintes systémiques et oculaires.Le but de ce travail est de montrer la place de l'ophtalmologiste dans la prise en charge du zona ophtalmique.Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective menée dans le service d'Ophtalmologie de l'HIA OBO entre 2016 et 2018, sur une série de patients, pris en charge pour zona ophtalmique.Résultats: Nous avons recruté 8 patients, dont 6 femmes.L'âge moyen était de 42,5 ans. Quatre patients étaient VIH (+). Tous nos patients avaient une cellulite orbitaire. La motilité oculaire était conservée chez tous les patients.L'acuité visuelle était basse chez la plupart. L'examen à la lampe à fente retrouvait une hyperhémie conjonctivale, un chémosis et une atteinte cornéenne. Tous nos patients ont bénéficié d'une bi-antibiothérapie, des antalgiques et des anti-viraux. L'évolution était marquée par la régression de la cellulite orbitaire, la cicatrisation cutanée, la récupération visuelle.Conclusion: Le zona ophtalmique est plus fréquent chez les sujets atteints de VIH, par rapport à la population générale. Correctement pris en charge, son évolution est favorable. Par contre, en l'absence de traitement antiviral, il s'accompagne de complications oculaires dans 50 à 70 % des cas
Subject(s)
Gabon , Herpes Zoster Ophthalmicus/epidemiology , Herpes Zoster Ophthalmicus/nursing , Orbital CellulitisABSTRACT
Background: Although childhood cancers are rare, increases in incidence have been observed in recent times. There is a paucity of data on the current incidence of childhood cancers in South Africa.Aim: This study described the epidemiology of childhood cancers in a section of the private health sector of South Africa, using medicines claims data.Setting: This study was designed on a nationally representative medicine claims database. Method: A longitudinal open-cohort study employing children younger than 19 years and diagnosed with cancers between 2008 and 2017 was conducted using medicine claims data from a South African Pharmaceutical Benefit Management company. Cases were identified using International Classification of Diseases, Tenth Revision (ICD-10) diagnostic codes C00 to C97, together with a medicine claim reimbursed from oncology benefits. Crude incidence rates were calculated per million persons younger than 19 years on the database and standardised using the Segi 1960 world population. Temporal trends in incidence rates, analysed using the joinpoint regression, were reported as annual percentage changes (APCs). Results: Overall, 173 new cases of childhood cancers were identified in the database, translating into an age-standardised incidence rate (ASR) of 82.3 per million. Annual incidence of cancer decreased from 76.7 per million in 2008 to 58.2 per million in 2017. More incident cases were identified in males (68.8%). The highest proportion of incident cases was recorded for leukaemias (39.9%), the 59 year age group (34.1%) and the Gauteng Province (49.7%).Conclusion: The incidence of childhood cancers decreased over time in the section of the private health sector studied. Leukaemias were the major drivers of childhood cancer incidence
Subject(s)
Adolescent , Health Facilities, Proprietary , Insurance Claim Review , Neoplasms/epidemiology , South AfricaABSTRACT
Context: Contraceptive prevalence in Nigeria is low at 17%. Amongst Nigerian women and couples who accept to use contraception, the IUCD is the most commonly used contraceptive method with variation in rates of use between geographical areas and among Health Institutions. Factors that determine decision making on IUCD use are not well understood. Aims: To study the use, effectiveness, complications and discontinuation rates for intrauterine contraceptive device received at the University of Benin Teaching Hospital from 1997 to 2016 and analyzed in January, 2019. Study Design: This was a retrospective cross sectional study. Methodology: The case notes of all 3326 new clients who accepted Copper T intrauterine contraceptive device at the UBTH Family Planning Clinic during the review period were retrieved and analyzed. Data regarding acceptors socio-demographic characteristics, side effects, effectiveness, complications, duration of use and reasons for discontinuation were extracted and entered into SPSS for windows version 22.0 and analyzed. Results: Out of the 8203 clients that accepted to commence a family planning method, 3326 (40.55%) accepted to use IUCD. The mean age of IUCD acceptors at commencement was 33.4±5.60 and the mean age of their husbands was 39.85±6.91. The mean parity was 3.73±1.87 (range 0-12), while the mean number of living children was 3.56±1.66 (range 0-10). The mean duration of use (in months) was 40.43±40.13. Women with 5 or more children (P Value 0.000) and at least a minimum of secondary education (P Value 0.000), were significantly associated with IUCD use duration of > or more than 2 years. Also, women who reported satisfaction with IUCD (P Value 0.000) and no complications (P Value 0.000) were also associated with longer duration of use. Conclusion: IUCD is a common family planning method used by women at UBTH. Its duration of use is higher among clients with more children, at least a minimum of secondary school education and no complications from its use. This information is relevant for family planning service providers to increase contraceptive uptake by women in Nigeria
Subject(s)
Contraception/epidemiology , Family Planning Policy , Intrauterine Devices/trends , NigeriaABSTRACT
Background. Spina bifida (SB) is a neural tube defect (NTD) that has an increased risk of fatal and disabling effects if not repaired early, i.e. within the first 24 to 48 hours of life. Its diagnosis holds an increased burden for the patient and the caregiver owing to secondary complications. The effects of the disease are detrimental even with early repair, because of the long-term disabling nature of the disease.Objective. This retrospective study aimed to assess the effects of demographics, immediate post-surgical complications and impact of time to surgical intervention on the outcome of neonates with open SB (OSB) admitted to the neonatal intensive care unit (NICU) at Inkosi Albert Luthuli Central Hospital (IALCH) in KwaZulu-Natal, South Africa (SA), between January 2011 and December 2015.Methods. A retrospective chart review was conducted at the NICU of IALCH. All neonates diagnosed with SB were identified. The study period was from 1 January 2011 to 31 December 2015. Data were collected from the IALCH electronic database. All neonates with SB admitted to the IALCH NICU were included; any patient who presented beyond the neonatal period (i.e. >28 days) was excluded from the study. Data collected included maternal demographics. Additionally, neonatal history was reviewed and post surgery complications evaluated. Outpatient management post discharge was reviewed.Results. One hundred and fifty neonates were included (58% male). The mean (standard deviation) maternal age was 26.7 (6.6) years. Only 10% had an antenatal diagnosis of OSB. Seventy-eight percent were born at term and 22% prematurely. The lumbar/sacral region was the most commonly affected. More males (14%) had thoraco/lumbar lesions than females (7.8%). Forty-eight percent presented before 3 days of life (early presentation). In the late-presentation group, there was an association with wound sepsis (p=0.003). Twenty-five percent were repaired between days 0 and 3 of life and 75% after 3 days. Postoperative complications in patients whose open SBs were repaired beyond 3 days of life were not statistically significant compared with those with early repair; all were p>0.05. There was a borderline association of prolonged hospitalisation with wound sepsis (p=0.07). Long-term outcomes showed that 68% had lower limb dysfunction, 18% urological complications, 14% limb deformity, and 11% hydrocephalus. A minority had psychomotor (7%) and developmental (15%) disorders. Ten percent required readmission secondary to shunt complications, and 7% died. Conclusion. SB remains a significant disease burden that affects outcome and survival of neonates in SA. Lack of good antenatal care, which includes early ultrasound and timely referral to centres, are barriers to good outcomes. Long-term follow-up is also necessary to prevent morbidity
Subject(s)
Infant, Newborn , Neural Tube Defects , Neurosurgical Procedures/complications , Neurosurgical Procedures/epidemiology , Neurosurgical Procedures/methods , South Africa , Spinal DysraphismABSTRACT
Introduction: Neonatal sepsis is one of the most common causes of neonatal morbidity and mortality in developing countries.Objective: This study aimed to determine the prevalence and factors associated with neonatal sepsis among hospitalized new-borns at Ruvuma, southern Tanzania.Methods: A facility-based retrospective study was conducted at Songea Regional Referral hospital in Ruvuma, during August-October, 2018. A standardized questionnaire was used to collect demographic, obstetric and clinical information from medical case files of patients. Neonatal sepsis was diagnosed clinically. Data were analysed using SPSS version 24.0. Chi square test was used to assess relationship between outcome and exposure variables. Multivariate logistic regression was used to measure association after controlling for confounders, and P-values of <0.05 were statistically significant.Results: Medical case files of 263 neonates were reviewed. Of these, 131(49.8%) had sepsis. Factors associated with neonatal sepsis were prematurity (AOR=2.2; 95%CI. 1.3 3.6, p=0.002), age of more than a week (AOR=2.2; 95%CI. 1.0 4.6, p=0.04), intravenous cannulation after birth (AOR=6.3; 95%CI. 2.1 19.0, p=0.002), and resuscitation with nasal oxygen prongs (AOR=1.7; 95%CI. 1.1 2.9, p=0.02).Conclusions: Neonatal sepsis is relatively common among neonates in Ruvuma and is associated with maternal and health services related factors. The findings underscore the importance of routine assessment and close monitoring of neonates
Subject(s)
Child, Hospitalized , Infant, Newborn , Neonatal Sepsis/epidemiology , Neonatal Sepsis/mortality , Risk Factors , TanzaniaABSTRACT
Introduction. Les fractures deDupuytrensont des fractures graves, secondaires aux accidents de trafic routier, touchant plus les adultes jeunes. L'objectif de cette étude était de déterminer le profil épidémiologique des malades présentant la fracture de Dupuytren et de décrire les caractéristiques anatomopathologiques de ces fractures afin de définir la prise en charge adéquate de ces patients cibles.Méthodologie.Cette étude transversale, descriptivea été réalisée au Département de Chirurgie des Cliniques Universitaires de Kisangani, sur une période de 11 ans, du 1er Janvier 2003 au 31 Décembre 2013. Cinquante-six fractures de Dupuytren ont été retenues suivant les critères d'inclusion de l'étude.Résultats.La prévalence des fractures de Dupuytren était 9,5% des cas, intéressant plus les adultes jeunes âgés de 30 à 40 ans, sans différence significative entre le sexe masculin et le sexe féminin. La fracture de Dupuytren basse a été majoritaire (82,1% de cas). L'accident de trafic routier était la cause principale de nos fractures avec 34 cas soit 60,71%. Le choc indirect a été le mécanisme le plus retrouvé chez nos traumatisés avec 49 cas soit 87,5%.Conclusion.Les fractures de Dupuytren sont fréquentes à Kisangani touchant plus souvent l'adulte jeune actif. Elles sont généralement basses etsecondaires aux accidents de trafic routier avec prépondérance des fractures ouvertes
Subject(s)
Democratic Republic of the Congo , Dupuytren Contracture , Dupuytren Contracture/epidemiology , Dupuytren Contracture/pathologyABSTRACT
But : Décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des blessures de guerres au centre de santé de référence de Douentza. Patients et Méthode : Il s'agissait d'une étude descriptive incluant les patients pris en charge entre le 1er Décembre 2017 et le 31 Décembre 2018 au centre de santé de référence du district sanitaire de Douentza. La stratégie de prise en charge des blessés adoptée était celle de MARCHE et selon les principes de la chirurgie de guerre. Résultats Au total nous avons reçu 71 blessés de guerre au centre de santé de Douentza. Cette série était composée de 66 hommes, de 34 (48%) militaires et représentait 63% des urgences chirurgicales (n=113) et 30% des interventions chirurgicales réalisées dans l'établissement. Les lésions siégeaient sur les membres dans 53% des cas; 23% sur l'abdomen (traumatismes abdominaux pénétrant et/ou perforants) et 15% sur la région dorso-lombaire. Elles étaient causées par des engins explosifs improvisés (48%), des balles (37%) et des armes blanches (15%). Il s'agissait de plaies abdominales dans 11 cas (16%) dont 4 plaies perforantes et 7 plaies non pénétrantes, de plaies vasculaires dans 7 cas (10%), de délabrements cutanéo-musculaires dans 21 cas (30%), de broiements de la main dans 1 cas et d'écrasement également dans 1 cas (1%). Les lésions étaient infectées à l'admission dans 25% des cas et un état de choc était retrouvé chez 15% des patients. 68% des patients étaient référés dans une structure plus équipée pour prise en charge appropriée. L'échographie seul examen para clinique disponible, était utilisée 33 fois (46%) pour explorer l'abdomen. Elle était contributive au diagnostic 11 fois (33%). Sur le plan thérapeutique, le parage chirurgical était d'emblée réalisé chez 53 patients (75%). 16 décès (23%) ont été déplorés, suites à des traumatismes cranio-cérébraux (n=2), plaie cervicale (n=1), péritonites (n=3), polytraumatisme (n=1) et 9 décès ont été constatés à l'admission. Conclusion Les blessés de guerre sont des urgences chirurgicales graves menaçant le pronostic vital immédiat et/ou fonctionnel à long terme. Leur prise en charge exige une organisation et des équipements spécifiques. Le centre de santé de Douentza à l'instar des autres centres de santé du Mali, disposant d'un faible plateau technique et sans plan d'urgence s'est trouvé confronté à l'accueil d'un nombre croissant de blessés de guerre pour lesquels, il n'était pas préparé. La gestion de ces blessés a été difficile d'où la nécessité de repenser les missions des centres de santé de cercle et le niveau de leur plateau technique
Subject(s)
Community Health Centers , Mali , War-Related Injuries/diagnosis , War-Related Injuries/epidemiology , War-Related Injuries/therapyABSTRACT
Background: Physical inactivity is one of the major risk factors of non-communicable diseases (NCDs), such as type 2 diabetes, cardiovascular diseases, obesity, certain cancers, and all-cause mortality. Office employees are particularly exposed to such diseases, due to the nature of their work, which mainly involves passive activities that require less energy expenditure. Objectives: The objective of the study was to assess the leisure-time physical activity participation (LTPAP) among government employees in Kigali, Rwanda, as well as to highlight the factors that motivate, or hinder their participation. Methods: A cross-sectional, descriptive quantitative study was conducted with 600 participants. A stratified sampling technique was used to determine the study sample from the Government of Rwanda's Sports Policy stakeholder institutions. Then, a convenience sample of participants was selected from each stratum to form the final study sample. Data were collected using a three-part customised, self-administered questionnaire to capture demographic data, leisure-time physical activity levels (LTPA) using the Godin-Shephard questionnaire, and the factors that influenced participation. Analysis was done using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Descriptive and inferential statistics were employed to summarise and draw meaningful associations between different variables. Results: More than half (61.1%) of the participants were not sufficiently active. Physical activity levels declined significantly with advancing age (p = 0.004) and increasing working experience (p = 0.002); female participants were less active than males. The prevention of diseases and maintenance of good health were the most frequently reported contributors (48.8%) to physical activity participation, while time and tight work schedules were the most frequently reported hindrances (62.2%). Conclusion: The majority of government office employees in Kigali did not engage in sufficient leisure-time physical activity, hence they may be at high risk of developing NCDs. Strategies to increase LTPA among employees should be implemented
Subject(s)
Cross-Sectional Studies , Exercise , Leisure Activities , Noncommunicable Diseases/epidemiology , Noncommunicable Diseases/prevention & control , RwandaABSTRACT
Introduction : La syndactylie congénitale est une fusion plus ou moins complète des doigts de la main et/ou des orteils. C'est la plus fréquente des anomalies congénitales de la main. Le but de cette étude était d'analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques des syndactylies congénitales de la main dans une structure spécialisée en chirurgie de la main. Patients et méthodes: Cette étude était rétrospective, monocentrique,et descriptive. Elle a concerné des enfants âgés de moins de 15ans hospitalisés entre janvier 2002 et décembre 2017 dans le service de chirurgie plastique et reconstructrice du CHU Aristide le Dantec de Dakar pour une syndactylie congénitale de la main. Les données recueillies étaient épidémiologiques cliniques, thérapeutiques, et évolutives. Résultats : Il s'agissait de 61 patients (113 commissures). Il y avait 44 garçons et 17 filles. L'âge moyen à l'intervention était de 6 mois (3mois-7ans). La notion de consanguinité était rapportée chez 39 patients (64%) et chez 14% (n = 6) d'entre eux, il existait un antécédent de syndactylie familiale. Aucun diagnostic anténatal n'a été posé La malformation était bilatérale chez 22 patients (36 %). La syndactylie était simple complète (n=29; 47,5%), simple incomplète (n=19 ;31%) et complexe (n=13 ;21,5%). Les commissures concernées étaient la 1ère (n=4 ; 3,5%), la 2ème (n=20 ; 17,5%), la 3ème (n=56 ; 49,5%) et la 4ème (n=33 ; 29,5%). Une malformation associée était objectivée chez 21 (34 ,5%) patients dont 14 syndactylies du pied. Quarante-huit (78%) patients (68 commissures) ont eu un geste chirurgical dans un délai inférieur à 1 an pour 94,64% (n=45). L'incision en zig-zag était la seule technique pratiquée pour la séparation digitale. La séparation commissurale était faite selon une plastie en VY (n=28 ; 58,5%), en V croisé (n=15, 31%), et en rectangle (n=5 ; 10,5%). La réparation utilisait une greffe de peau totale inguinale (n=36, 75%), une greffe associée à une plastie (n=6, 12,5%) et une plastie (n=6, 12,5%). Des complications ont été notées chez 15 (31%) patients. Il s'agissait de six récidives partielles, six nécroses de greffe dont deux en rapport avec une infection et trois cicatrices chéloïdiennes. Quarante (83 %) patients avaient un résultat satisfaisant avec un recul moyen de 12 mois (3 - 48). Conclusion : Les syndactylies simples et complètes étaient les plus fréquentes. Les 3ème et 4ème commissures étaient les plus intéressées. La réparation par plastie en VY associée à une greffe de peau totale était couramment réalisée. Les résultats étaient satisfaisants. Le suivi à long terme est compromis. Il est lié aux difficultés socio-économiques des patients
Subject(s)
Child , Hand , Patients , Senegal , Syndactyly , Syndactyly/epidemiologyABSTRACT
Introduction: La fasciite nécrosante est une urgence chirurgicale et médicale. Cette étude avait pour objectif de décrire le profil épidémiologique, clinique, et thérapeutique des patients ayant une fasciite nécrosante dans un service de chirurgie plastique en milieu tropical. Méthodes : il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive de dossiers des patients traités pour une fasciite nécrosante entre janvier 2015 et décembre 2017. Les paramètres d'étude concernaient l'épidémiologie, les signes, le traitement et l'évolution. Les lésions cutanées ont été classées selon les critères de Wong. Le score LRINEC a été établi. Résultats : Sur la période d'étude, 947 patients ont été reçus. Dix-huit avaient une fasciite nécrosante soit 1.9% des patients. Cette étude a concerné 11patients. Il y avait neuf femmes et deux hommes. L'âge moyen était de 47 ans. Tous les patients avaient un faible revenu économique. Une porte d'entrée était notée (n=8). Les pathologies médicales commorbides associées étaient le diabète (n=5), l'infection au VIH (n=2) . La prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens a été noté (n=5). L'usage de cataplasmes était enregistré (n= 8). La notion de prise d'alcool a été notée (n=2). Le délai moyen de consultation était de 29 jours. Les lésions siégeaient au membre inférieur ( n=9) et au membre supérieur (n=2). Le diagnostic était clinique. Les lésions étaient du stade 3. Le score LRINEC a été établi chez huit patients. Il était inférieur à 6 (n=4), égal à 6 (n=2), supérieur ou égal à 8(n=2). Le traitement médical comportait la ceftriaxone associée au métronidazole. Une excision des tissus nécrosés a été faite dans les 24 heures suivant l'admission. Une greffe de peau mince a été réalisée dans un délai moyen de 28,7 jours. Un décès a été enregistré (patiente atteint du VIH avec score LRINEC=13). Au recul moyen de 14 mois il n'y avait pas de récidive. Conclusion : La fasciite nécrosante est rare. Les lésions ont intéressé en général des patients de sexe féminin avec un âge moyen de 47ans. Ils avaient des pathologies médicales commorbides associées à des degrés variables. Le traitement traditionnel à type de cataplasme est un facteur favorisant. La consultation est tardive. Les lésions concernaient les membres inferieurs dans la majorité des cas. Elles étaient de stade 3. Une excision des tissus nécrosés et une greffe de peau mince après la formation d'une granulation ont été faites. Le traitement médical comportait la ceftriaxone associée au métronidazole. Un décès a été noté. Au recul moyen de 14 mois il n'y avait pas de récidives
Subject(s)
Africa , Extremities , Fasciitis, Necrotizing , Fasciitis, Necrotizing/epidemiology , Patients , Surgery, PlasticABSTRACT
Objectifs : Décrire les aspects épidémiologiques et le traitement des ostéomyélites chroniques de membres. Patients et Méthodes : Une étude rétrospective des dossiers de patients traités pour une ostéomyélite chronique de membre a été réalisée. Les patients ont été opérés entre janvier 2013 et décembre 2016 Les renseignements recueillis étaient épidémiologiques, cliniques, radiologiques, biologiques, thérapeutiques, et évolutifs. Résultats : Cinquante quatre patients étaient traités. Il y avait 42 (78%) hommes et 12 (22%) femmes. L'âge moyen était de 13,91±10,09 ans (2-46). Les patients ayant un âge inférieur à16 ans représentaient 74%(n=40) de la population. Trente-sept (68%) des patients provenaient des zones rurales. Le motif de consultation était la fistule chez 40 (74%) patients. La lésion était unifocale (n=50;93%). Le délai moyen de consultation était de 25,96 ±16,60 mois. La majorité des lésions siégeaient au tibia (n=30 ; 52%), au fémur (n=14 ; 24%), et à l'humérus (n=10;17%). Les lésions étaient localisées à la diaphysaire et métaphysaire dans 41 (74%) cas. Le séquestre était noté chez tous les patients. La culture était positive chez 39 patients. Le Staphylococcus aureus était le germe isolé dans (n=20;51,2%). Le traitement consistait en une séquestrectomie couplée à une antibiothérapie. Au recul moyen de16,11±5,65 mois, le taux de guérison était de 87%. Conclusion : L'ostéomyélite chronique de membres en milieu tropical atteint les adolescents. Les os longs concernés par ordre de fréquence étaient le tibia, le fémur, et l'humérus. La diaphyse et la métaphyse étaient les localisations de prédilection. Les séquestres étaient les lésions anatomiques prédominantes Le Staphylococcus aureus était le germe le plus isolé. La séquestrectomie associée à l'antibiothérapie était le traitement standard. Le taux de guérison était de 87%
Subject(s)
Africa South of the Sahara , Extremities , Osteomyelitis , Osteomyelitis/epidemiologyABSTRACT
Introduction : l'hépatite aiguë est fréquente et représente un problème de santé publique dans les pays en développement. Les étiologies sont dominées par l'hépatite A en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Cependant, très peu d'études locales ont porté sur cette pathologie. Objectif : Étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs des hépatites aiguës chez les enfants hospitalisés au CHNEAR. Matériel et Méthodes : il s'agissait d'une étude rétrospective réalisée au CHNEAR de Dakar du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017. Étaient inclus les enfants hospitalisés pour une hépatite aiguë. Les données socio démographiques, cliniques, paracliniques et évolutives ont été recueillies. L'analyse des données uni et bivariée était faite grâce au logiciel R studio version 3.5.0. Résultats : au total, 35 000 enfants étaient hospitalisés durant la période d'étude parmi lesquels 71 patients avaient une hépatite aiguë déterminant une prévalence hospitalière de 0,2%. L'âge moyen à l'admission était de 65 mois avec un sex-ratio de 1,5. L'ictère cutanéo-muqueux était le principal signe physique (81,7%). La cytolyse était constante avec une moyenne des ALAT de 549UI/L. Une insuffisance hépatocellulaire était notée chez 24% des patients. L'étiologie était dans la grande majorité des cas indéterminée (66,2%). L'hépatite A représentait 15,5% et la phytothérapie (18,3%). L'évolution était favorable dans l'ensemble sans aucun cas de rechute. La létalité était de 16,9%. Conclusion : l'étiologie des hépatites demeurent encore indéterminées dans une large proportion au CHNEAR de Dakar. Le pronostic reste réservé pour les formes graves avec insuffisance hépatocellulaire
Subject(s)
Academic Medical Centers , Child , Disease Progression , Hepatitis A/diagnosis , Hepatitis A/epidemiology , Hepatitis A/etiology , Hepatitis, Viral, Human , SenegalABSTRACT
Introduction : les décès des nouveau-nés demeurent encore un problème majeur de santé en Afrique malgré les ressources déployées. Le diagnostic des infections bactériennes materno-fÅtales semble être souvent fait en excès avec un usage abusif des antibiotiques. L'objectif de l'étude était d'analyser les critères de diagnostic des infections materno-fÅtales bactériennes et d'apprécier l'usage abusif des antibiotiques. Patients et méthodes : il s'agissait d'une enquête descriptive réalisée dans le service de Néonatologie de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant de Ndjamena et basée sur l'étude des dossiers de tous les nouveau-nés hospitalisés au cours de la période du 1er Janvier au 30 Avril 2019 avec un âge inférieur à 72 heures de vie à l'admission, diagnostiqués pour une infection materno-fÅtale et ayant reçu une antibiothérapie pendant au moins 48 heures. L'antibiothérapie a été considérée comme abusive si elle n'avait pas été arrêtée à la 48ème heure, en l'absence de tout argument biologique en faveur d'une infection materno-fÅtale bactérienne. Résultats : Sur 404 nouveau-nés hospitalisés au cours de la période d'étude, 170 étaient retenus pour infection maternofÅtale soit une fréquence de 42%. En se basant sur les critères rigoureusement définis d'infection néonatale certaine, d'infection néonatale probable ou pas d'infection néonatale, la fréquence était de 16,3% avec 1 cas d'infection certaine et 65 cas d'infection probable. Les nouveau-nés prématurés représentaient 24,2% du lot. Les détresses respiratoires et les signes neurologiques étaient les principales manifestations cliniques à l'admission. Tous les nouveau-nés avaient reçu comme antibiotiques Céfotaxime et Gentamycine. L'évolution s'était faite vers le décès dans 19,7% des cas et chez 62,5% des nouveau-nés prématurés. Le point de l'antibiothérapie à 48 heures d'hospitalisation a été faite chez 15,3% des nouveau-nés. L'usage des antibiotiques n'était pas justifié et était considéré comme abusif chez les 104 nouveau-nés ne présentant pas une infection soit 25% des admissions du service. Conclusion : La fréquence des infections materno-fÅtales était surestimée à 42% dans le service de néonatologie de Ndjamena avec un taux d'usage abusif des antibiotiques de 25%. Cela amène à suggérer le renforcement des capacités sur la prévention des infections en maternité et une meilleure application des recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé