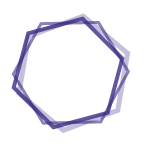ABSTRACT
Objective: To describe findings from an external quality assessment programme involving laboratories in Africa that routinely investigate epidemic-prone diseases.Methode Beginning in 2002, the Regional Office for Africa of the World Health Organization (WHO) invited national public health laboratories and related facilities in Africa to participate in the programme. Three surveys comprising specimens and questionnaires associated with bacterial enteric diseases, bacterial meningitis, plague, tuberculosis and malaria were sent annually to test participants' diagnostic proficiency. Identical surveys were sent to referee laboratories for quality control. Materials were prepared, packaged and shipped in accordance with standard protocols. Findings and reports were due within 30 days. Key methodological decisions and test results were categorized as acceptable or unacceptable on the basis of consensus feedback from referees, using established grading schemes.Findings Between 2002 and 2009, participation increased from 30 to 48 Member States of the WHO and from 39 to 78 laboratories. Each survey was returned by 6493% of participants. Mean turnaround time was 25.9 days. For bacterial enteric diseases and meningitis components, bacterial identification was acceptable in 65% and 69% of challenges, respectively, but serotyping and antibiotic susceptibility testing and reporting were frequently unacceptable. Microscopy was acceptable for 73% of plague challenges. Tuberculosis microscopy was satisfactorily performed, with 87% of responses receiving acceptable scores. In the malaria component, 82% of responses received acceptable scores for species identification but only 51% of parasite quantitation scores were acceptable.Conclusion The external quality assessment programme consistently identified certain functional deficiencies requiring strengthening that were present in African public health microbiology laboratories
Subject(s)
Africa , Delivery of Health Care , Infections , Laboratories , Malaria , Meningitis , Plague , Quality Control , TuberculosisABSTRACT
A review of plague records from 1986 to 2002 and household interviews were carried out in the plague endemic villages to establish a pattern and spatial distribution of the disease in Lushoto district; Tanzania. Spatial data of households and village centres were collected and mapped using a hand held Global Positioning System and Geographical Information System. During the 16-year period; there were 6249 cases of plague of which 5302 (84.8) were bubonic; 391 (6.3)septicaemic; and 438 (7.0) pneumonic forms. A total of 118 (1.9) cases were not categorized. Females and individuals aged 7-18 years old were the most affected groups accounting for 54.4(95CI: 52.4-56.0) and 47.0(95CI: 45- 49) of all reported cases; respectively. Most cases were found in villages at high altitudes (1700-1900m); and there was a decline in case fatality rate (CFR) in areas that experienced frequent outbreaks. Overall; there was a reduction in mean reporting time (from symptoms onset to admission) to an average of 1.35 days (95CI: 1.30-1.40) over the years; although this remained high among adult patients (18 years). Despite the decrease in the number of cases and CFR over the years; our findings indicate that Lushoto district experiences human plague epidemic every year; with areas at high altitudes being more prone to outbreaks. The continued presence of plague in this focus warrants further studies. Nonetheless; our findings provide a platform for development of an epidemic preparedness plan to contain future outbreaks
Subject(s)
Humans , Demography , Plague/epidemiology , Plague , EpidemicsABSTRACT
La boîte de Kartman associe, dans un même réceptacle, un rodenticide à action lente et un insecticide à action rapide. Elle offre l'opportunité de lutter contre les réservoirs et contre les vecteurs de la peste. Cette méthode a été évaluée dans deux quartiers de la ville d'Antananarivo en associant la communauté à cette lutte. Le rodenticide utilisé a été le diféthialone 25 ppm (Baraki®) et l'insecticide, un carbamate en poudre à une concentration de 3% (Propoxur ®). Le schéma de l'étude réalisée d'octobre 2002à mai 2003 repose sur une comparaison entre un "quartier traité" et un "quartier témoin".L'analyse a porté sur 4 variables : (1) le nombre quotidien de rats trouvés morts, (2) le nombrequotidien d'appâts non consommés restant dans les boîtes, (3) la prévalence des rats porteurs de puces, et (4) l'index pulicidien des rats. Les variables 3 et 4 ont été obtenues à partir de rats piégés vivants à une fréquence mensuelle. Le nombre de rats morts dans le quartier traité a été de 968 versus 3 dans le quartier témoin. Les autres variables étudiées ont atteint un niveau d'équilibre à partir du 4 ème mois. Ainsi, entre J120 et J180, la moyenne quotidienne du nombre d'appâts non consommés a été de 2,79 dans le quartier traité versus 0,14 dans le quartier témoin, la prévalence des rats porteurs de puces a été de 0% dans le quartier traité (n=2 rats) versus 61% dans le quartier témoin(n=42 rats), et l'index pulicidien de ces rats dans le quartier traité a été 0 versus 5,0 dans le quartier témoin. Cette étude démontre l'efficacité de cette méthode pour atteindre les réservoirs et les vecteurs de la peste urbaine. Sous réserve d'utilisation correcte, la boîte de Kartman a sa place parmi les moyens de lutte contre la peste dans les contextes inter-épidémiques ou épidémiques
Subject(s)
Madagascar , Plague , Plague/prevention & controlABSTRACT
La peste est entrée à Madagascar en 1898, à partir du port de Toamasina, suite à l'escale d'un bâteau venant d'Inde. En 1921, elle arrive à Antananarivo et s'étend sur les Hautes Terres Centrales en y provoquant des épidémies sans précédent pendant près de 20 ans. Jusqu'au début des années 1980, elle a persisté à bas bruit surtout en milieu rural, avant de connaître une reviviscence au point de constituer un problème de santé publique de nos jours. La peste urbaine existe surtout dans la ville d'Antananarivo (réémergence en 1978 après 28 ans de silence apparent) et dans le port de Mahajanga (réémergence en 1991 après 63 ans de silence apparent). La re-dynamisation du programme national de lutte contre la peste, à partir de 1994, a permis une meilleure surveillance de la maladie. Cette analyse a pour objectif une actualisation des données épidémiologiques de la peste humaine à Madagascar, à partir des cas déclarés (16 928 cas suspects dont 3 500 confirmés ou probables) obtenus au Laboratoire Central à l'Institut Pasteur de Madagascar de 1980 à 2001. La saison pesteuse sur les hautes terres se situe d'octobre à mars et celle de la ville de Mahajanga de juillet à novembre. Le sex-ratio homme/femme est de 1,3/1, la tranche d'âge la plus touchée est celle des sujets âgés de 5 à 25 ans. Le taux de létalité de 40% au début des années 1980 a diminué à 20% vers la fin des années 1990, le pourcentage de formes pulmonaires est passé de 15% à moins de 5%, indiquant une amélioration de la prise en charge des cas. Par contre, on a assisté à une extension géographique de l'endémie pesteuse dans le pays : 4 districts confirmés en 1980, un pic de 30 districts en 1999 et 21 districts en 2001. En 2002, la diffusion d'un nouveau test de diagnostic rapide de la peste (bandelettes), dans les centres de santé de base des 42 districts endémiques, devrait contribuer à diminuer la morbidité et la létalité due à la peste, et améliorer sa surveillance au niveau national
Subject(s)
Madagascar , Plague/diagnosis , Plague/epidemiology , Plague/prevention & controlABSTRACT
Après avoir touché Madagascar en 1898, la peste a atteint Antananarivo en 1921 et s'est étendue sur les Hautes Terres Centrales où elle persiste jusqu'à nos jours. Une recrudescence des cas a été constatée depuis une vingtaine d'années pendant lesquelles, la peste a réemergé dans la capitale Antananarivo et, dans le port de Mahajanga après respectivement 28 et 63 ans de silence apparent. Le programme national de lutte et de surveillance a, de ce fait, été renforcé. L'évolution de l'endémie dans le temps et dans l'espace au cours de cette période a été analysée à partir de 2 982 cas bactériologiquement confirmés ou probables(sex-ratio H/F : 1,3/1). L'incidence annuelle moyenne des cas de peste confirmés ou probables est passée de 33 pendant la période 1980-1984 à 298 pendant la période 1995-1999. Cette augmentation s'est accompagnée d'une large extension géographique de la zone d'endémie, passant de 17 à 37 districts pour la plupart situés à plus de 800 m d'altitude, sauf le port de Mahajanga. Par contre, le taux de létalité a baissé pendant la même période, passant de 41,6% à 20,7%. Un des objectifs des recherches actuelles est une meilleure compréhension des différents cycles épidémiologiques de la peste à Madagascar, afin d'améliorer les stratégies de lutte
Subject(s)
Madagascar , Plague/epidemiology , RecurrenceABSTRACT
La surveillance de la peste murine en 1995 dans le marché de gros Tsenabe Isotry à Antananrivo a montré une circulation intense du bacille pesteux (80% de rats séropositifs) et un index cheopis (8,4) supérieur au seuil classique de risque épidémique (>1). Pourtant, le nombre de malades suspects déclarés dans ce quartier est très faible (3 cas suspects sans confirmation de 1995 à 1999). Dans le but de vérifier si la faible incidence de la peste humaine pouvait être due à l'acquisition d'une immunité, une enquête séroépidémiologique a été menée auprès des marchands en juin 1999 associée à l'analyse des données de la surveillance des rongeurs entre 1998 1999. La séroprévalence des porteurs d'anticorps anti-F1 est de 3,2% (3/95 marchands), alors que les marqueurs de la transmission de la peste chez les rongeurs et les puces continuent d'être très élevés. Ces résultats suggèrent que l'incidence de la peste parmi les marchands n'est pas liée à une immunité acquise, mais probablement à d'autres facteurs : le faible contact entre l'homme et les puces de rat en raison de l'abondance des rats, l'absence d'épizootie murine due à la résistance des rats de la capitale et le comportement du rongeur prédominant Rattus norvegicus moins commensal que R. rattus
Subject(s)
Bacteriology , Madagascar , Plague/epidemiologyABSTRACT
Les auteurs rapportent les résultats d'une enquête séroépidémiologique destinée à évaluer l'importance de la peste dans la ville de Mahajanga en juillet 1999. 656 sérums issus d'un échantillon de sujets de 2 ans et plus tirés au sort dans la population par sondage en grappes ont été étudiés en utilisant une technique ELISA pour la recherche des anticorps anti-F1. Le taux de prévalence des anticorps anti-F1 est de 6,1 p. 1000, proche de la prévalence attendue dans cette ville où la peste est réapparue en 1991 après 62 ans de silence. L'enquête a également montré que la musaraigne endémique, Suncus murinus, joue sans doute un rôle comme réservoir de la peste à Mahajanga
Subject(s)
Madagascar , Plague/diagnosis , Plague/epidemiologyABSTRACT
Le diagnostic bactériologique de la peste est basé sur la microscopie et l'isolement de Yersinia pestis à partir de prélèvements suspects. Lorsque la culture et l'inoculation à la souris sont négatives, l'examen direct du frottis permet de poser un diagnostic de présomption de peste. Examen simple à réaliser a priori, la microscopie pose cependant de réelles difficultés de lecture et de reproductibilité entre deux laboratoires. Cette étude compare les résultats obtenus au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Mahajanga et au Laboratoire Central de la Peste (LCP), lors des deux épidémies successives de peste en 1995 et 1996.En prenant la culture comme référence, la microscopie réalisée à Mahajanga est plus sensible mais moins spécifique que celle réalisée au LCP. Entre l'année 1995 (350 patients) et 1996 (245 patients), la concordance entre les 2 laboratoires s'est améliorée, passant de 55% à 75%. Malgré une sensibilité et une spécificité assez faibles par rapport à la culture (elle-même peu sensible aussi en raison des conditions de transport des prélèvements), la microscopie conserve toute sa valeur pour le diagnostic de présomption de la peste lorsqu'elle est faite par un personnel entraîné. La solution idéale à terme sera un test immunodiagnostique simple et rapide, réalisable par des agents de santé non biologistes
Subject(s)
Academic Medical Centers , Bacteriology , Madagascar , Microscopy , Plague/diagnosis , Yersinia pestisABSTRACT
La peste est aujourd'hui considérée par l'OMS comme une maladie résurgente dans le monde. A Madagascar, on assiste à sa recrudescence : 150 à 250 cas par an sont notifiés confirmés ou probables. La peste sévit surtout sur les Hauts-Plateaux où 32 Services de Santé de District sont concernés. Parmi eux, le district d'Antananarivo-ville où 23 cas contrôlés ont été recensés en 1996. Sur les côtes, la maladie a réapparu en 1991, dans la ville portuaire de Mahajanga après 63 années de silence apparent; entre 1991 et 1997, 3 épidémies sont survenues : 180 cas ont été confirmés ou probables de peste. A Antananarivo, la surveillance de la population murine a montré une circulation intense du bacille pesteux. Fait préoccupant, les puces vectrices, Xenopsylla cheopis, récoltées des rats capturés ont montré une résistance aux principales familles d'insecticides dont les pyréthrinoïdes. Cette situation alarmante exige un système d'alerte et de riposte. La mise à disposition d'un test de diagnostic simple, très rapide et sûr aux services sanitaires périphériques devrait améliorer les mesures de riposte devant un cas confirmé de peste